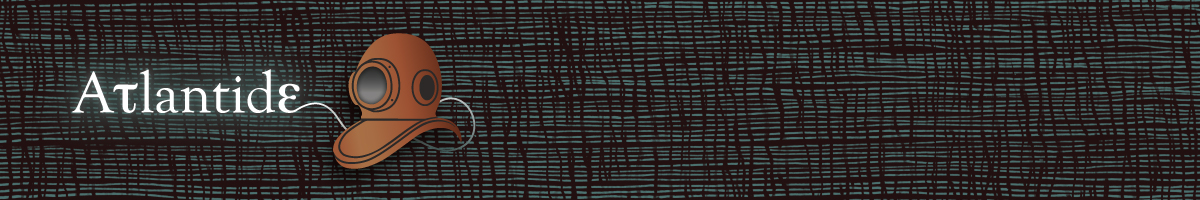Le souci de l’environnement (en hindi vātāvaraN)1 a émergé au XXe siècle en Inde comme dans le reste du monde et a donné lieu à de nombreuses actions, gouvernementales et non gouvernementales. Son imaginaire cependant est complexe et, dans une assez large mesure, vient compliquer l’élaboration d’une pensée indienne de l’environnement qui ne saurait s’identifier simplement à la pensée globalisée de l’environnement, doublement étrangère : parce qu’elle est originaire du monde occidental, parce qu’elle méconnaît les représentations indiennes en ce domaine2. L’imaginaire indien de l’environnement hérite en effet de toutes les implications de la notion de prakRti en sanskrit qui, comme le rappelle Annie Montaut, est entendue aujourd’hui comme « nature », par opposition à la « culture », sanskRti, mais qui, à l’origine, constitue avec sanskRti « les deux faces d’une même notion, celle de l’agir » (Montaut, 2013, p. 280). Les deux termes sont construits à partir de la racine verbale kR, « faire » : prakRti désigne une action qui se déploie, une dynamique de développement, une énergie (comme l’indique le préfixe pra- « avant »), tandis que sanskRti est une action aboutie, parachevée (san- signifie « ensemble »), ordonnée par ce qui est le principe par excellence du perfectionnement et de l’action, le rite. La distinction, qui régit aussi bien la langue (les prakrits, prākRta, vs. le sanskrit), ne relève pas d’une opposition binaire simple : les prākRta, prākrits (« langues naturelles ») sont compris dans la tradition comme dérivés du sanskrit. La distinction ne fonde même pas une opposition, puisque prakRti et sanskRti sont deux mots qui désignent la même chose, le monde et sa marche. Entre l’homme et la nature, le vocabulaire des langues indiennes ne pose donc pas une scission, c’est-à-dire une opposition terme à terme ; mais il ne met pas non plus en place une séparation qui permette une relation sans fusion (Voir Neyrat, 2015)3. C’est cette intégration profonde de ce qui entoure l’homme dans un ordre de l’action qui rend délicate l’émergence de la notion d’environnement au sens contemporain du terme — rappelons toutefois que le terme français est, dans ce sens, un emprunt relativement récent à l’anglais —, du moins dans un premier temps, car elle ouvre aussi, dans un second temps, la possibilité d’une pensée de l’interaction.
1. La nature comme métaphore
La nature et l’histoire des hommes sont en Inde difficilement séparables et les manifestations de la nature en Inde ne se comprennent pas hors de l’empreinte humaine, comme le montre de façon remarquable un article de Jean Filliozat de 1980. En exploitant les compétences des deux départements de l’Institut français de Pondichéry, le Département d’indologie et celui d’écologie, celui-ci rend compte de la pauvreté présente d’une région de l’Inde méridionale aujourd’hui déforestée, mais dont la richesse en monuments de diverses époques n’en est que plus intrigante (voir Filliozat, 1980, p. 104).
Cette réalité humaine qui n’est pas propre à l’Inde trouve dans la littérature classique indienne une extraordinaire chambre d’échos : comparants privilégiés des êtres humains, les éléments de la nature leur sont toujours rapportés. Les comparaisons dont use de façon conventionnelle la poésie sanskrite — faisant du corps féminin une liane ou un paysage éclairé par la lune du visage, etc. — ont fait le ravissement des premiers lecteurs européens ; et avec la traduction qu’il a proposée de « paysage intérieur » (interior landscape) le poète et critique A. K. Ramanujan (1929-1993) a popularisé l’extraordinaire codification de la relation amoureuse dans la littérature tamoule ancienne du Sangam (caṅkam) où à chaque état est associé un paysage (montagne, forêt, mer, campagne, désert), ainsi que tout un réseau d’images en correspondance (moment du jour, saison, fleur, plante, animal, nature de l’eau et des sols, occupations humaines, etc.) (voir Ramanujan, 1967 et 1999). Quant à l’évocation, fortement conventionnelle, de la nature dans la poésie indo-tibétaine d’inspiration bouddhique, elle sert d’abord à illustrer l’enseignement relativement abstrait délivré par le Bouddha (voir Masset, 2004, passim.).
La nature pour elle-même est rarement l’objet du discours, comme le manifeste le titre de la collection de contes kannada traduits par le même Ramanujan (A Flowering Tree and Other Tales from India, 1997), recueil publié de façon posthume, où l’image de l’arbre en fleurs constitue, dans le conte éponyme, une figure du féminin dans sa fécondité comme dans sa fragilité – image qui existe déjà dans la langue : en tamoul aussi bien qu’en sanskrit, une femme qui a ses règles est dite « en fleurs » (puSpavatī en sanskrit). La protagoniste du conte a le pouvoir de se transformer en arbre fleuri, mais lorsque, surprise par sa jeune belle-sœur, elle se trouve contrainte à le faire, elle se voit soumise à la négligence et à la brutalité de celle-ci et de ses compagnes, et devient un pauvre corps mutilé et muet. Dans un texte portant le même titre que le conte, publié en annexe du volume posthume, Ramanujan note qu’il est possible de faire du conte une lecture « écologique » qui inviterait à traiter la nature avec ménagement (Ramanujan, 1997, p 219) ; mais l’essentiel de son analyse porte sur la richesse du réseau métaphorique mis en œuvre par le récit. C’est une perspective du même ordre qui justifie, à l’échelle du recueil, la reprise de l’arbre en fleurs comme image d’un patrimoine oral à protéger.
Poète, Ramanujan a intitulé « Ecology » un des poèmes de son recueil Second Sight (1986) qui évoque, au début de la mousson, la floraison des champak rouges, grands arbres de la famille des magnoliacées, très odoriférants :
[...]
our three Red Champak trees
had done it again,
had burst into flower and given Mother
her first blinding migraine
of the season
(Ramanujan, 1995, p. 124-125)4
Bien que victime de ces floraisons entêtantes, la mère se refuse à ce qu’on abatte un arbre en fleurs, dont la graine fut semée afin de produire chaque année de pleins paniers de fleurs pour les dieux, pour ses filles, belles-filles et petites-filles, et, ajoute le poète « and for one line of cousins / a dower of migraines in season » (« et pour une lignée de cousins / un douaire de migraines à la saison »). La mère est « écologiste », note non sans ironie le poète, moins par respect d’une nature à préserver en tant que résidence des hommes, que par sens d’un ordre des choses que l’homme le premier souffre et subit — ordre des choses qui, traditionnellement, est l’objet de l’épopée en Inde.
Dans le monde indien comme ailleurs, l’usage métaphorique de la nature est en effet un trait qui pointe vers l’épique, et c’est bien dans l’épopée qu’il faut chercher, en dernier ressort, au sein de la littérature indienne, cette conception du monde catastrophique qui empêche l’épanouissement d’un imaginaire écologique de la catastrophe naturelle, de la catastrophe qui arrive par la nature, mais aussi à la nature.
2. Les implications de l’imaginaire épique
L’épopée en Inde n’appartient pas en effet au passé. Le vaste ensemble où l’on réunit sous ce terme les Mahābhārata et RāmāyaNa à la fois classiques et populaires dans leurs versions diverses, les très nombreuses traditions orales du sous-continent ou encore les épopées modernes composées au XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle, manifeste au plus haut point la permanence de l’imaginaire épique jusqu’aujourd’hui en Inde. Or, cet imaginaire est un imaginaire de la catastrophe nécessaire, par laquelle l’ordre des choses se perpétue en se détruisant régulièrement, et dont les hommes sont à la fois les acteurs et les victimes.
En témoigne un récit récent, qui ne se présente pas comme une épopée — l’auteur parle d’« histoire », et l’éditeur de la traduction française d’« oratorio » : GangāvataraN, du poète bengali Lokenath Bhattacharya (1927-2001), traduit en français en 1993 sous le titre, littéral, de La Descente du Gange par son épouse France Bhattacharya5. Né sur les bords du Gange, ayant étudié à Santiniketan, l’université fondée par Tagore, puis en France, Bhattacharya a été fortement marqué par la poésie française et francophone — il traduisit Rimbaud, Michaux, Char — ; mais c’est sous le signe des mythes et de la littérature de l’Inde qu’il inscrit dès le titre GangāvataraN. L’expression « descente du Gange » désigne un épisode fameux de la mythologie indienne rapporté notamment dans le RāmāyaNa (I, XLII-XLIV). Le sage Bhagīratha a obtenu par son ascèse que le Gange, fleuve céleste, féminin dans les langues indiennes — Gangā —, descende sur terre remplir l’océan et purifier ainsi les cendres de ses ancêtres maudits pour avoir troublé l’ascèse du sage Kapila. Mais le dieu Brahma prévient que la chute de Gangā menace de tout détruire sur la terre. Bhagīratha accomplit donc une année supplémentaire d’ascèse, debout sur une jambe, afin que le dieu Śiva accepte de retenir la chute des eaux de Gangā dans son chignon infini. Après s’être longuement égaré dans les tresses du dieu, le fleuve s’écoule calmé jusqu’à l’océan. L’épisode est représenté — c’est l’hypothèse la plus probable — sur un rocher à Mahābālipuram au Tamil Nadu, en un relief de vingt-sept mètres sur neuf, sans doute un des plus grands du monde, qui exploite une anfractuosité de la roche pour suggérer la chute du fleuve. Le motif, où l’action humaine ascétique successivement entraîne et empêche la catastrophe, a connu une fortune certaine dans la modernité indienne qui n’hésite pas à recourir au mythe pour se dire : premier film parlant indien, en 1937, GangāvataraN est un film mythologique consacré à la descente du Gange —, c’est aussi le dernier film du grand réalisateur marathi Dadasaheb Phalke. Le poète kannadiga D.R. Bendre (1986-1981) donna ce même titre au recueil de poèmes qu’il fit paraître en 1951, tandis que le dramaturge contemporain Rajendra Karanth choisit de nommer ainsi la pièce qu’il consacra en 2010 à Bendre.
La Descente du Gange de Bhattacharya ne réécrit pas l’épisode mythologique, mais s’attache à un groupe de pèlerins redescendus du glacier de Gangotri dans l’Himalaya. Origine d’une des sources du Gange, Gangotri est un des lieux les plus saints de l’hindouisme, et l’objet d’un pèlerinage fervent à plus de 4000 mètres. Le chemin est périlleux, notamment en raison des glissements de terrain pendant la mousson qui se sont multipliés ces dernières années — en juin 2013, les pluies dans les vallées environnantes ont emporté plus de cinq mille personnes dans une des plus grandes catastrophes naturelles du pays, baptisée par certains le « tsunami de l’Himalaya ». Mais ce n’est pas ce genre de catastrophe que narre le récit de Bhattacharya.
Sous la conduite d’un des leurs, nommé Lokenath (comme l’auteur), les pèlerins s’efforcent de dire à l’assemblée du village de Bhaironghat, au pied de la montagne, ce qu’ils ont vu une fois parvenus aux sources du Gange :
Kanak : Il n’y avait plus de glacier, plus un seul, nulle part. Il n’y avait plus de neige sur aucun sommet.
Samiran : On ne voyait qu’une sorte d’énorme gueule de requin. Le mont Bhagarathi ressemblait à un tas de charbons calcinés...
[...]
Brindaban : Aussi loin que portait le regard il n’y avait que cela, que cela : le cataclysme incarné qui, langue pendante, nous entourait d’une extrémité à l’autre de l’horizon. (Bhattacharya, 1998/2006, p. 124)
C’est le spectacle d’un dessèchement monstrueux, d’une pollution, à entendre d’abord au sens rituel. En effet, le constat ne donne pas lieu d’emblée à une interrogation sur les causes d’une telle disparition des glaces — qui peut faire penser à ce qu’on a constaté au sommet du Kilimandjaro, par exemple. Bien plutôt, il fait l’objet d’une interprétation, et est reçu avec effroi comme un signe, le signe d’une fin du monde sous forme de déluge, de « descente du Gange » : « Quoi qu’il en soit, même si c’est pour un temps assez court ou sur une petite surface, il va sans dire qu’en conséquence de ce désastre une énorme quantité de glace et de neige va fondre et que cette eau, se déversant du haut des montagnes, va emporter tout sur son passage, tout ce qui se trouve dans les plaines jusqu’à l’océan. » (p. 243 ; voir aussi les expressions « le fleuve de la fin du monde », p. 278, et « le déluge », p. 324).
Ce signe avait lui-même été précédé de présages (prophétie apocalyptique d’un ascète, orage épouvantable lors de la nuit à Shonprayag). Aussi le récit se dédouble-t-il, pour faire retour sur les signes lus, et en découvrir de nouveaux : par l’intervention d’une femme en pleurs, Sounanda, une nouvelle narration est proposée, non sans difficulté, de la nuit d’orage à Shonprayag, nuit pendant laquelle la jeune femme vécut une expérience terrible et irrésistible de l’adultère. Si elle-même ressent sa faute comme cause de la catastrophe, il n’en va pas ainsi pour ses compagnons de pèlerinage qui voient dans cette faute le signe d’une faute plus générale, et font dès lors de la pécheresse mutique la porteuse de signes, la voix de la catastrophe, la prophétesse. Le récit du rêve qu’elle fit cette nuit-là, dans lequel elle donnait naissance à un enfant démoniaque, puis voyait par anticipation la scène de Gangotri qui eut lieu huit jours plus tard, avant de se retrouver dans un pays envahi par la lèpre, engage la logique onirique de la fin du texte, où la vision hallucinée, ponctuée par l’audition hallucinée de bruits inquiétants, soutient la description d’un début de fin du monde.
Or, cette conversion des phénomènes en signes qui est au cœur de l’écriture du récit polyphonique, emporte elle-même sur son passage toute autre analyse possible. Quand les hommes cherchent des causes, ils s’accusent de péchés, ou plus exactement ils accusent l’une d’entre eux : Sounanda en est la figure emblématique. L’auto-accusation de Sounanda est par ailleurs débattue. Un personnage, Dhrouba, récuse l’analyse en termes moraux : « Mais pourquoi est-ce que tu parles à ce propos de péché et de crime ? Ce qui s’est passé n’est rien d’autre qu’une catastrophe naturelle » (p. 231), et Lokenath un peu plus loin explique à Sounanda que son sentiment de culpabilité, dans sa disproportion, est plus un signe d’orgueil que de tout autre chose (voir p. 241). Tout se passe alors comme si annuler l’idée de faute, c’était aussitôt annuler celle de catastrophe : « Peut-être que demain matin les cimes de l’Himalaya auront retrouvé leur couverture neigeuse » (p. 231), poursuit Dhrouba.
En évoquant les destructions successives du monde, Lokenath se refuse cependant à penser que cette catastrophe-là soit simplement naturelle, autrement dit qu’elle ne soit pas catastrophique : « J’ai l’impression, et nous sommes nombreux à partager cette opinion que cette fois, c’est la faute des hommes » (p. 266). Cet énoncé de la responsabilité humaine ne rompt pas pour autant avec une pensée métaphorique de la nature : tout autant que la pensée qui inclut l’homme dans la nature sans autre forme de procès, celle qui pense l’un dans les termes de l’autre ne permet guère de faire émerger la notion d’un environnement avec lequel l’homme interagirait. Lokenath devient dès lors celui qui conduit ses compagnons vers l’acceptation d’une destruction nécessaire, qu’il refusait pourtant avec véhémence au début :
Brindaban : La création porte en son sein son enfant dont le nom est destruction.
Lokenath : Non, non, non, nous n’accepterons pas, nous n’accepterons pas. (p. 34)
Et le pèlerinage dans son échec même révèle son enseignement : on va à la source du fleuve faire l’apprentissage de la mort, cette mort que Lokenath a vu son grand-père atteindre, immergé dans le Gange, selon la coutume (voir p. 56).
Une telle pensée est inséparablement une poétique, puisque dire la faute — plutôt que la responsabilité — de l’homme, c’est aussi bien dire la destruction qui en est le signe et qui la sanctionne à la fois. Certes, dans une telle perspective, la disproportion demeure entre le peu que sont les hommes et l’énormité de l’apocalypse, mais c’est précisément le défi lancé au poète : « c’est une affaire énorme, cette destruction, cette force. Nous sommes des gens ordinaires, les plus insignifiants de tous. Comment comprendre cela et comment l’appréhender ? Quel nom lui donner et comment le décrire ? » (p. 269), s’interroge Lokenath. Le coupable que tous connaissent, qui est partout, ne peut être nommé dans les formules humaines, sinon celles qui dénotent les dieux (« Brindaban : Il est partout [...] Tout le pays résonne des louanges adressées à sa grandeur : le ciel, le vent… Samiran : Le soleil, la lune… », p. 274). Mais des images peuvent être données de ce qui s’est passé, et Lokenath (où se confondent en un même nom le personnage et l’auteur) retrouve celle de l’arbre miraculeux dont les fleurs et les tiges ont été arrachées :
Lokenath : Il y avait un arbre miraculeux dans notre jardin… Brindaban : Orné de fruits, de fleurs, de feuilles et de branches… [...]
Lokenath : [Un homme] a tout à coup arraché son lotus bleu. [...] La fleur est morte, elle est bien morte. Alors ensuite il s’est mis à arracher les tiges, l’une après l’autre, et avec quel soin ! Avec quelle persévérance ! Avec quelle concentration sans faille ! Comme il s’est installé, un couteau à la main, à côté d’un panier de légumes qu’il s’appliquait à éplucher…
Brindaban : Oui, oui, il épluche ! Il coupe une tige en fredonnant un air, puis arrache un pétale… (p. 283-287).
Le poète n’est pas sans savoir ce que ces images ont d’insuffisant, d’un point de vue logique — « Qu’est-ce qui est l’effet et qu’est-ce qui est la cause ? », demande Sounanda (p. 306) —, mais aussi moral :
Brindaban : En fait, le désastre qui s’est produit dans notre vie et que nous relions à la catastrophe naturelle, comment pouvons-nous le décrire de façon logique ? Avec quels mots ?
Samiran : Nous n’avons pas de mots pour le dire.
Kanak : S’il nous en reste encore, le peu que nous avons ne vient pas sur nos lèvres.
Dhrouba : La peur l’arrête.
Lokenath : C’est pourquoi nous prenons refuge dans le langage figuré. Nous délaissons pour des chemins détournés la langue droite que nous aurions pu emprunter peut-être. (p. 307).
Les images occultent, disent sans dire, participent de ce mensonge collectif où les mots perdent leur sens, où par exemple « fleur » désigne des excréments, dénoncent en chœur les cinq pèlerins narrateurs (voir p. 295). Faut-il y voir le naufrage du rêve de l’Indépendance (« Ils déchirent à belles dents notre rêve, notre indépendance ! » (p. 292) s’exclame Brindaban) ? Ou, plus radicalement, l’image de la pensée épique elle-même, prompte à retourner la destruction en création ? Le récit, après avoir ouvert cette béance, demeure ambigu. Lokenath annonce la reformation, encore invisible, de « formidables glaciers » (p. 311), et achève le récit dans une ultime prière, mais auparavant celui-ci s’est reconfiguré, dans le délire de Dhrouba face à la mort et à la belle Sounanda, comme une réécriture de l’épisode final du Mahābhārata où les cinq frères Pandava avec leur épouse commune Draupadi effectuent leur Grand Départ :
Nous sommes cinq, non ? Cinq frères, tout à fait comme les cinq Pandava. C’est l’épisode final du Mahabharata : la fin du Kouroukshetra. Maintenant nous sommes arrivés dans l’Himalaya avec notre Draupadi, sur le chemin du grand départ : Lokenath, Brindaban, Kanak, Samiran et Dhrouba. Lequel de nous sera Youdhisthira ? Lequel Bhima ? Et Arjouna ? Et Nakul ? Et Sahadeva ? (p. 320).
Deux interprétations sont possibles lorsque la scène se révèle ainsi comme champ de bataille (kurukSetra) : on peut y voir le grandissement, par-delà la petitesse humaine, de toute l’action à la hauteur de l’épopée, comme le suggèrent d’autres allusions au Mahābhārata, en particulier la mention d’un ciel de « kouroukshetra » (p. 56) au moment de la mort du grand-père de Lokenath. Mais on peut aussi être sensible à la démythification de l’épopée et de son cortège de violences qui se trouvent ramenées aux proportions d’un déchaînement de pulsions sexuelles : « Viens Sounanda, viens Draupadi, nous allons nous jeter sur toi. Toi aussi, jette-toi dans ce champ de bataille ! Que chacun de nous soit ta proie ! » (p. 321).
Qu’il la reconduise ou la mette en question, le récit confirme la permanence de la pensée épique dans l’imagination indienne et ses effets, que la romancière et militante Arundhati Roy regrette pour sa part explicitement dans ses essais, The End of Imagination en 1998, ou The Greater Common Good en 1999 (réunis en français dans Roy, 1999), où elle s’inquiète des conséquences désastreuses à ses yeux de la conjugaison d’un tel imaginaire et de moyens techniques modernes, qui vient soutenir la politique de puissance nucléaire indienne ou les projets de barrages gigantesques.
Dans son ambiguïté même, La Descente du Gange aide pour sa part à comprendre que l’imaginaire de l’environnement en Inde se soit développé dans un contexte hétérodoxe par rapport à la pensée hindoue dominante, à savoir les mouvements sectaires, les tribus et les femmes, femmes dont les revendications propres, comme le rappelle Martine van Woerkens, ont pris comme slogan « Nous, femmes de l’Inde, nous ne sommes pas des fleurs, nous sommes des étincelles de feu » (Woerkens, 2010, p. 155). Le refus des analogies entre la femme et la nature débouche en effet sur une autre conception du milieu naturel dont la femme peut dès lors devenir l’agent protecteur. Les premières manifestations d’un souci environnemental en Inde sont de ce point de vue significatives. Dès les années 1720, l’Inde a connu un mouvement écologique particulièrement original, celui de la communauté vishnouite Bishnoi (« Vingt-neuf », du nom des vingt-neuf principes de non-violence suivis par celle-ci) dans la région de Marwar au Rajasthan. Suivant l’exemple d’une femme de la communauté, Amrita Devi, les Bishnoi s’opposèrent à la coupe des arbres ordonnée par le Maharaja de Jodhpur, en entourant chacun un arbre de leurs bras. Trois cent soixante-trois Bishnoi périrent, mais par la suite, le Maharaja interdit par décret royal l’abattage des arbres dans tous les villages Bishnoi. Deux siècles et demi plus tard, dans les années 1970, le mouvement chipko (« enlacer » en hindi) au Garhwal, la région de la haute vallée du Gange en Uttarakhand évoquée par Bhattacharya, reprit la même stratégie, qui trouvait aussi une source d’inspiration chez Gandhi. Le mouvement comptait de très nombreuses femmes. Et c’est de la même région d’Uttarakhand qu’est originaire Vandana Śiva, physicienne engagée dans le mouvement altermondialiste, la lutte pour la défense de l’agriculture traditionnelle et la conservation de la biodiversité, et qui a consacré plusieurs ouvrages au mouvement chipko (voir Shiva, 1986 et 1993)6.
3. Conclusion
L’opposition entre un imaginaire épique catastrophiste et un imaginaire « écoféministe » et gandhien est bien sûr simplificatrice. Elle est sans doute insuffisante pour rendre compte de la complexité de la problématique environnementaliste en Inde — où le gouvernement a fait interdire de sortie de territoire en janvier 2015 une militante de Greenpeace qui, en luttant pour la préservation d’une forêt du centre de l’Inde menacée par l’ouverture d’une mine de charbon, mettrait en péril « la sécurité nationale » (Bouissou, 2015). Mais elle n’est pas sans pertinence dans l’écriture littéraire indienne, où jusqu’aujourd’hui la nature reste une métaphore que la littérature, une bonne part d’entre elle du moins7, ne cesse d’avoir vocation à déployer.