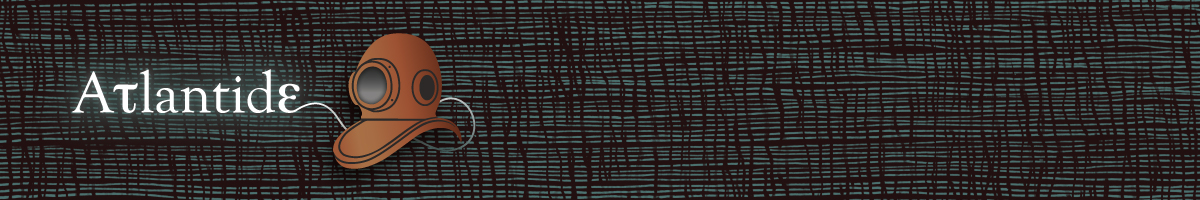Né en 1958 à Tianhu (Tiānhúzhèn 田湖镇), dans le district de Song (Sōngxiàn 嵩县), situé dans la province du Henan (Hénán 河南), Yan Lianke (Yán Liánkē 阎连科) est issu d’une famille appartenant au monde de la paysannerie : « j’ai grandi, déclare-t-il, dans une famille de paysans illettrés » (cité dans Nivelle, 2009). Ainsi, c’est dès l’enfance que Yan est en contact avec la longue, l’immémoriale culture paysanne chinoise. En témoigne la préface qu’il rédige en 2009 à son roman La Fuite du temps, où il exprime son regret de ne pas avoir mené une vie de paysan, comme ses frères et sœurs (voir la préface à La Fuite du temps, traduite en annexe). Mais, durant son existence, l’histoire de la Chine a connu des phases à la fois violentes et contrastées : les communes populaires, le Grand bond en avant, la Révolution culturelle, l’Ouverture et le capitalisme mondialisé. Aussi, comme la plupart des écrivains de sa génération, Yan intègre dans ses écrits une dimension politique clairement située sur le plan historique.
Si Yan est bien le produit d’une culture paysanne multiséculaire et de l’histoire moderne de la Chine, il se situe également dans cette période de renouveau de la littérature chinoise, qui commence au lendemain de la Révolution culturelle (1966-1976). On peut en effet déceler dans ses écrits certaines des modalités que prend la littérature romanesque chinoise à partir des années 1980. La « littérature de reportage » (bàogào wénxué 报告文学) caractérise d’une certaine façon Le Rêve du Village des Ding (Dīng zhuāng mèng 丁庄梦, 2006), roman décrivant l’épidémie de sida qui a sévi dans les années 1990 dans la province du Henan. En effet, avant d’écrire son roman, Yan Lianke passe de longs mois dans un village du Henan, menant une sorte d’enquête, si bien que, parallèlement au roman proprement dit, il formule l’intention de rédiger un véritable reportage : « J’espère qu’un jour je pourrai écrire un reportage dans lequel je raconterai en détail pour tout le monde ces faits inouïs, inimaginables et choquants. »1 (cité dans Zhang, 2006). C’est dire que la fiction, quand bien même elle ne se confond pas avec le réel, s’appuie, dans ce cas tout au moins, sur des sources factuelles.
On pourrait aussi classer les romans de Yan dans ce qu’il est convenu d’appeler la « littérature des cicatrices » (shānghén wénxué 伤痕文学), qui a tenté, au sortir de la Révolution culturelle, de panser les plaies de l’histoire tourmentée de la Chine maoïste, en en dénonçant les dérives. Ainsi, La Fuite du Temps (Rìguāng liúnián 日光流年, 1998) décrit les souffrances subies par les paysans chinois depuis l’époque contemporaine jusqu’aux premières années de la République populaire de Chine. De même peut-on associer l’œuvre de Yan à la « littérature de la recherche des racines » (xúngēn wénxué 寻根文学), apparue au milieu des années 1980, et généralement associée au « Mouvement d’envoi à la montagne et à la campagne » (shàngshān xiàxiāng yùndòng 山下乡运动) de ceux que l’on appelle les « jeunes instruits » (zhīshí qīngnián 知识青年, abrégé en zhīqīng) : pour créer des œuvres authentiques, il faut « rechercher les racines » de la culture chinoise, que l’on associe au savoir paysan, empreint parfois d’une coloration « magique », tel qu’il est préservé et transmis dans les milieux ruraux qu’ont appris à connaître les « jeunes instruits ». Ce qui singularise Yan Lianke, toutefois, c’est que, à la différence des « jeunes instruits » venus de la ville et déplacés de force à la campagne, il ne découvre pas cette culture à l’âge adulte, puisqu’elle fait partie du cadre dans lequel il a été élevé enfant et adolescent. Néanmoins, en ancrant ses récits dans un contexte rural traversé par une pensée qu’on pourrait qualifier de « sauvage », il participe bien de ce mouvement littéraire.
Il est encore possible de situer Yan Lianke par rapport aux écrivains dont il a manifestement subi l’influence. Ses écrits partagent avec ceux de Shen Congwen (Shĕn Cóngwén 沈从文, 1902-1988) et de Mo Yan (Mò Yán 莫言, 1955-) l’ancrage rural, le registre merveilleux, et parfois un ton critique vis-à-vis du pouvoir, mais il connaît de plus le même parcours que ces deux écrivains puisque tous trois ont servi dans l’armée populaire de libération. En effet, après avoir travaillé pendant deux ans dans une cimenterie à Luoyang (Luòyáng 洛阳), dans le Henan, entre 17 et 19 ans, Yan s’engage dans l’armée, en 1978, où son travail consiste à rédiger des textes de propagande. À cet égard, il connaît parfaitement, pour les avoir pratiqués, les ressorts de la rhétorique politique du Parti communiste chinois. Mais, comme pour Mo Yan, l’armée lui offre surtout la possibilité d’acquérir une formation. Il fait ainsi des études à l’Université du Henan, et obtient un diplôme de Sciences politiques en 1985. À partir de 1989, il suit les cours de l’Académie des Beaux-Arts de l’Armée populaire de libération (Jiĕfàngjūn yìshù xuéyuàn 解放军艺术学院), où il rencontre Mo Yan. Au terme de ces études, il obtient un diplôme de Littérature, en 1991.
Parmi les auteurs étrangers avec lesquels Yan offre des affinités, on peut mentionner Franz Kafka (1883-1924) et Gabriel García Márquez (1927-2014), deux auteurs qui ont certes marqué toute une génération de romanciers chinois, mais auxquels Yan a consacré un article (voir Yan, 2006b). Il partage avec l’un une tendance satirique associée à un ton parfois distant et souvent énigmatique, et, avec l’autre, l’ancrage dans le milieu rural ainsi que l’intérêt porté aux modes culturels qui caractérisent ce milieu (mais, comme nous l’avons vu, cet aspect s’explique aussi par le contexte interne à la littérature chinoise des années 1980). Enfin, l’on doit évoquer la possible influence d’Albert Camus (1913-1960). De même que Chronique d’une Mort annoncée (Crónica de una muerte anunciada, 1981) de Márquez a pu inspirer La Fuite du Temps (voir Tsai, 2011a, p. 92 et Tsai, 2011b), de même Le Rêve du Village des Ding pourrait être redevable à La Peste (1947) : on y trouve une situation similaire, celle de l’épidémie et de l’isolement consécutif d’une population, situation qui semble bien révéler chez certains individus un fonds moral orienté soit vers le bien (Rieux), soit vers le mal (Cottard). Mais c’est surtout la référence au mythe de Sisyphe (l’essai portant ce titre date de 1942), sur lequel nous reviendrons, qui constitue la dette la plus importante du romancier chinois à l’égard de Camus.
Après avoir écrit pour lui-même, dans son adolescence — il raconte que sa mère a brûlé un de ses romans (voir Nivelle, 2007) —, puis pour l’armée, il publie son premier texte de fiction en 1986 : il s’agit d’une nouvelle intitulée Petit village, petite rivière (Xiăo cūn xiăo hé小村小河). En 1994, dans un roman intitulé La Chute du soleil en été (Xià rìluò 夏日落), Yan s’emploie à démystifier les idéaux que l’on associe au type du héros soldat qui faisait l’objet de ses précédents récits : l’ouvrage est censuré. C’est le début d’une relation compliquée entre l’auteur et le pouvoir : certains de ses romans sont en effet censurés, comme ce roman-ci ainsi que deux autres sur lesquels nous reviendrons. Ces tensions avec le pouvoir se redoublent d’une difficulté à rencontrer son public en Chine continentale. Si le roman suivant, Les Jours, les mois, les années (Nián yuè rì年月日, 2002) est un de ceux qui est le plus apprécié des Chinois (il avait été récompensé par le prix Lu Xun dès sa première publication dans la revue Moisson (Shōuhuò 收获), les ouvrages qu’il publie par la suite ne rencontreront guère de succès, à l’exception d’un livre de souvenirs (Songeant à mon père [Wŏ yú fùbèi 想念父亲]), voir Yan, 2008/2017). En 2003, il publie un roman à la verve satirique radicale : un chef de district décide de racheter à la Russie le corps momifié de Lénine pour développer le « tourisme rouge » dans son village. Le roman est intitulé en français Bons Baisers de Lénine (Shòuhuó 受活, cette expression dialectale du Henan signifie la « joie de vivre »). Yan Lianke évite de peu la censure, mais il est prié par sa hiérarchie de quitter l’armée, ce qu’il fera l’année suivante, en 2004. Non sans ironie, le roman obtiendra le prix Lao She l’année suivante. Yan avoue avoir été « renvoyé et en même temps libéré de l’armée » (cité dans Nivelle, 2009). Il songeait en effet, depuis un certain temps, à se consacrer entièrement à l’écriture. Après l’armée, il travaille quelques années dans l’Association des écrivains chinois (Zhōngguó zuòjia xiéhuì 中国作家协会), et, depuis 2009, il occupe un poste de professeur de littérature à l’Université du Peuple (Rénmín Dàxué 人民大学), à Pékin.
Le roman qui succède à Bons baisers de Lénine — Servir le peuple (Wèi rénmín fúwù为人民服务, 2005) — n’échappe pas à la censure. Situé, comme ses premiers romans, dans le milieu de l’armée, le récit traite, sous la forme d’une farce, du culte de la personnalité voué à Mao sous la Révolution culturelle. Il semble que Yan s’impose ensuite à lui-même ce qu’il désignera comme une auto-censure lors de la rédaction du Rêve du Village des Ding (2006) : « J’ai volontairement évité, dans mon roman, de retranscrire de nombreuses situations authentiques mais terrifiantes. Le véritable village, avec ses habitants et les malheurs qu’ils ont connus, ne pouvait entrer dans un roman. »2 (cité dans Zhang, 2006). Il avoue, dans un entretien au Guardian : « Je me suis auto-censuré de façon très stricte. Je n’ai pas mentionné les responsables politiques. J’ai minimisé les faits. » Aussi croit-il que « l’auto-censure était parfaite »3 (cité dans Watts, 2006). Il semble même reconnaître à la censure une certaine vertu, car l’écrivain est contraint, en quelque sorte, de déployer une forme de créativité : « [La censure] a apporté de nouvelles significations à mes écrits, et parfois j’ai pu faire des compromis en recourant à certaines techniques d’écriture et en usant de stratégie »4 (cité dans Toy, 2007). Mais, malgré cette stratégie peut-être bénéfique, Le Rêve du Village des Ding fait à nouveau l’objet d’une censure, sous la forme d’une triple interdiction de distribution, de vente et de promotion. Repensant à cette amère expérience, il se reproche de s’être censuré en vain, et déclare, dans un autre entretien au Guardian : « En tant qu’auteur, j’aurais dû prendre davantage mes responsabilités, ce que je n’ai pas fait. »5 (cité dans Branigan, 2013). Il entend désormais essayer, autant que possible, d’écrire librement, ce qui l’amène parfois à publier à Hongkong ou à Taïwan certains de ses romans : c’est le cas des Quatre livres (Sì shū 四书, 2011), qui porte sur le Grand bond en avant, et de l’un de ses derniers romans, La Mort du soleil (Rìxī 日熄, 2016), tous deux parus aux éditions Maitian (Màitián麦田) à Taipei (Táibĕi 台北).
Yan Lianke est donc un écrivain en partie reconnu en Chine : en témoignent les prix littéraires qu’il y a obtenus (Lu Xun en 2000 et Lao She en 2005). Mais il est surtout reconnu en dehors de Chine, comme l’attestent le prix Franz Kafka, qu’il obtient en 2014, ainsi que les nombreuses traductions dont ses romans font l’objet, en particulier en français (à ce titre, les éditions Philippe Picquier ont publié neuf romans, dont les traducteurs sont Sylvie Gentil, Brigitte Guilbaud et Claude Payen).
Nous nous proposons d’examiner trois romans de Yan Lianke qui posent, souvent de façon indirecte, des questions relatives à l’environnement. Le premier, dans l’ordre chronologique est La Fuite du Temps. Ce roman est publié une première fois en 1998 aux éditions Huacheng (Huāchéng chūbănshè 花城出版社) à Canton (Guăngzhōu 广州), puis en 2001 aux éditions Shidai wenyi (Shídái wényì chūbănshè时代文艺出版社) dans le Jilin (Jílín 吉林), et de nouveau en 2004 aux éditions Chunfeng wenyi (Chūnfēng wényì chūbănshè 春风文艺出版社) dans le Liaoning (Liáoníng 辽宁), puis en 2009 aux éditions Shiyue wenyi (Shíyuè wényì chūbănshè 十月文艺出版社). Il est également publié à Taïwan en 2010 aux éditions Lianjing (Liánjīng chūbănshè 联经出版社) à Taipei. La traduction française de Brigitte Guilbaud est parue aux éditions Philippe Piquier en 2014. Le roman se situe dans le Village des Trois-Patronymes (Sānxìngcūn 三姓村), dont les habitants souffrent de la « maladie de la gorge obstruée » (hóudŭzhèng 喉堵症), qui les fait mourir avant l’âge de quarante ans. Certains villageois croient avoir trouvé un moyen pour remédier à leur misère : les hommes vendent leur peau, qui sert pour les grands brûlés, tandis que les femmes vendent leurs corps. La vie du village, retracée sur plusieurs générations, est traversée de luttes multiples : rivalités amoureuses, luttes pour le pouvoir, et combat collectif contre la misère et la maladie. Par ailleurs, la structure du récit adopte un mouvement à rebours du temps, en opérant une remontée du présent vers le passé, de la vieillesse proche de la mort — « Sima Lan va mourir » (Yan, 1998/2014a, par la suite : FT, p. 9) est la première phrase du roman — à la naissance — la dernière phrase est la suivante : « dans l’utérus, [...] Sima Lan [...] tend la tête et s’efforce de venir en ce monde. » (FT, p. 606).
Le deuxième roman que nous avons retenu, intitulé Les Jours, les mois, les années (Nián yuè rì), a paru en Chine en 2002, aux éditions du Peuple du Xinjiang (Xīnjiāng Rénmín chūbănshè 新疆人民出版社), et a également été traduit par Brigitte Guilbaud, en 2009. Sur le ton de la fable, ce récit d’environ 150 pages, met en scène le dernier habitant d’un village, un vieillard, en lutte, avec son chien, contre la sécheresse qui détruit la nature.
Enfin, nous avons sélectionné un des romans les plus connus de Yan Lianke, Le Rêve du Village des Ding, initialement publié en 2006 aux éditions Wenyi de Shanghai (Shànghăi wényì chūbănshè 上海文艺出版社). Comme nous l’avons déjà précisé, le roman a pour cadre l’épidémie de sida qui sévit dans la province du Henan dans les années 1990, faisant entre 200 et 300 000 victimes. La vente forcée du sang des villageois, pratiquée dans des conditions sanitaires inouïes, a provoqué l’épidémie, face à laquelle l’État est resté passif, à la différence de ce qui s’est passé lors de l’épidémie du SRAS de 2003. De plus, les responsables politiques sont restés impunis (voir Haski, 2005). Yan a été alerté dès 1995 par une doctoresse, Gao Yaojie (Gāo Yàojié 高耀洁), qui s’était engagée dans la lutte contre l’épidémie. L’écrivain prend en charge deux orphelins, qui vont ensuite mourir. Par la suite, il effectue une série de sept séjours dans un village du Henan, entre 2003 et 2006, aux côtés d’un anthropologue médecin sino-américain : tous deux viennent en aide, sur le plan médical et financier, aux victimes. Yan conçoit deux projets : une fiction d’une part et, comme nous l’avons vu, un documentaire. Le récit fictionnel est confié à un enfant, lui-même victime indirecte de la contamination. Son grand-père a incité autrefois les villageois à vendre leur sang pour obtenir une source de revenus. C’est le père de l’enfant, fils du grand-père par conséquent, qui met en œuvre cette vente, en recrutant des volontaires. Il s’enrichit, non seulement en empochant des commissions, mais également en vendant les cercueils, pourtant distribués gracieusement par les autorités, ou bien en organisant des mariages entre jeunes enfants morts en bas âge... Le grand-père, alerté en particulier par une série de rêves, finit par tuer son fils. Il est emprisonné. Puis, une fois libéré, quand il revient au village, il constate qu’il ne reste qu’une vaste plaine désolée.
Malgré des différences, notamment dans le registre, tantôt réaliste, tantôt merveilleux, et dans le degré d’engagement de l’auteur, ces trois romans suivent une ligne narrative assez semblable. Comme Yan le déclare, « [l]es Chinois sont habitués aux catastrophes, c’est notre histoire… » (cité dans Nivelle, 2009). Le point de départ des romans est donc bien une catastrophe qui survient dans un milieu paysan : famine, sécheresse ou épidémie. Cette catastrophe entraîne ensuite des conséquences d’ordre sanitaire et environnemental. Dans Le Rêve ainsi que dans La Fuite, l’origine de la catastrophe est humaine. Se met alors en place une forme de lutte de la part des paysans que l’on peut répartir dans trois catégories : les hommes de pouvoir, qui trompent en toute conscience ; les hommes idéalistes, qui veulent à tout prix appliquer leurs théories ; et les hommes ordinaires, qui tentent simplement de résister contre la mort, car l’enjeu est toujours vital. Parfois, ces trois catégories tendent à se confondre chez certains personnages : dans Le Rêve, le grand-père Ding Shuiyang, à l’origine de la vente de sang des villageois, semble racheter sa faute en créant une sorte de vie communautaire dans son école (voir Yan, 2006a/2009 (par la suite RVD), p. 75).
Pour mettre en ordre les éléments de notre analyse, nous reprendrons l’opposition que Roland Barthes développe entre le sens obvie et le sens obtus dans un article des Cahiers du cinéma consacré à l’analyse de photogrammes extraits d’Ivan le Terrible d’Eisenstein. Barthes tente de définir un « troisième sens » (c’est le titre de l’article), relatif à ce qu’il nomme la « signifiance », au-delà de la « communication » et de la « signification ». La « communication » concerne le contenu informatif perçu. La « signification » envisage le niveau symbolique, en lien avec un contexte historique, culturel, mais aussi personnel :
Le sens symbolique [...] s’impose à moi par une double détermination : il est intentionnel (c’est ce qu’a voulu dire l’auteur) et il est prélevé dans une sorte de lexique général, commun, des symboles : c’est un sens qui me cherche, moi, destinataire du message, sujet de la lecture, un sens [...] qui va au-devant de moi : évident, certes (l’autre l’est aussi) mais d’une évidence fermée, prise dans un système complet de destination. Je propose d’appeler ce signe complet le sens obvie. Obvius veut dire : qui vient au-devant, et c’est bien le cas de ce sens, qui vient me trouver ; en théologie, nous dit-on, le sens obvie est celui « qui se présente tout naturellement à l’esprit ». (Barthes, 1970/1982, p. 45)
Malgré un discours parfois indirect, voire allégorique, les romans de Yan se prêtent en effet à une première lecture dont le sens est relativement clair : il s’agit de dénoncer les jeux de pouvoir et leurs terribles conséquences pour la population. À ce sens obvie, qui, précisément « tombe sous le sens », s’ajoute toutefois un sens obtus, ainsi défini par Roland Barthes :
Quant à l’autre sens, le troisième, celui qui vient « en trop », comme un supplément que mon intellection ne parvient pas bien à absorber, à la fois têtu et fuyant, lisse et échappé, je propose de l’appeler le sens obtus. (Barthes, 1970/1982, p. 45)
Ce supplément de sens n’est sans doute pas totalement contrôlé par le romancier, et ne correspond peut-être pas non plus au « discours » qu’un lecteur occidental pourrait attendre d’un romancier dont la fiction comporte une dimension politique.
1. Sous le signe de l’obvie : la satire du pouvoir
Yan Lianke n’est pas un écrivain engagé au sens politique du terme, comme l’était par exemple Liu Xiaobo (Liú Xiăobō 刘晓波,1955-2017), mais, dans de nombreux écrits, et en particulier dans son roman Fēng Yă Sòng (风雅颂) (le titre pourrait être traduit par « Airs, odes, hymnes », car il s’agit d’un emprunt aux trois genres poétiques que comporte le Classique des poèmes (Shī jīng 诗经), il reproche aux intellectuels leur silence complice avec un pouvoir corrompu : « je critiquais le silence et l’inaction des intellectuels qui se disent qu’il n’y a pas moyen d’agir, dès lors on n’agit pas… Et ils cherchent tous à s’intégrer dans le système » (cité dans Mialaret, 2009). Il précise la visée de ce roman dans un autre entretien à Libération : « Le roman décrit des intellectuels qui ont fui la réalité pour se réfugier, encore une fois, dans un paradis imaginaire. C’est ce qui se passe en Chine : la plupart des artistes, enseignants, écrivains, refusent de parler du réel. C’est pourtant leur devoir de témoigner, de traduire des faits dérangeants, la littérature ne doit pas s’éloigner de l’histoire » (cité dans Nivelle, 2009). Il réitère ces reproches en 2013, dans un entretien au Guardian : « Les intellectuels chinois n’ont pas suffisamment pris leurs responsabilités. Ils trouvent toujours une excuse, disant qu’ils n’ont pas de raison de prendre la parole, ou que le contexte ne s’y prête pas »6 (cité dans Branigan, 2013). Il inclut même parmi les intellectuels silencieux son ami et maître Mo Yan (dont le pseudonyme, comme on sait, signifie « ne parle pas »). Plus généralement, il dénonce, parmi les nouvelles générations chinoises, une « amnésie politiquement organisée ». Il constate en effet que les jeunes Chinois ne savent plus ce qu’est, par exemple, le Grand Bond en avant. Ils sont victimes d’une sorte d’effacement de la mémoire, qui n’est pas un processus naturel (comme l’oubli), mais la conséquence d’un système idéologique et politique fondé sur la censure : « Cet effacement de la mémoire est pris en charge par la censure des journaux, des magazines, des journaux télévisés, de l’Internet et de tout ce qui conserve les souvenirs. »7 (Yan, 2013)
1.1. Un discours engagé qui porte en partie sur l’environnement
Une première lecture des trois romans fait en effet apparaître un discours engagé, qui porte, au moins partiellement ou indirectement, sur des questions environnementales. On peut tout d’abord repérer quelques références explicites. La pollution des eaux est ainsi évoquée dans La Fuite : l’eau que les habitants du Village des Trois-Patronymes parviennent à acheminer jusqu’à leur village, au prix d’efforts proprement surhumains, est en fait polluée :
— Regardez ! c’est une catastrophe ! (s’écrient les villageois.)
Les regards se nouent pour observer : l’eau coule, lame jaune et boueuse sous le soleil, natte qui ne cesse de s’enrouler, charriant herbes, feuilles et bouts de bois, et tout cela tourbillonne à un demi-chi de hauteur. Bientôt, tout près d’eux, l’eau exhale une puanteur glacée, une odeur noire, âcre et salée […] ; l’air pur et léger de l’automne s’en trouve tout enfumé.
[…] Herbes maculées, rats morts aux ventres gonflés, sacs de plastique emplis de fange, vêtements et chapeaux usagés, ventres rouges, peaux et poils blancs de bestiaux, tout cela se bouscule et se heurte à la surface de l’eau. (FT, p. 201-203)
Un des villageois explique la cause de la catastrophe : « Lorsque nous sommes arrivés au bout du canal, on a vu que tout avait changé là-bas, plus rien d’une ville de campagne, mais une capitale avec un tas d’usines et d’immeubles. Les toits des bâtiments dépassent la cime des montagnes. Là-bas, l’eau de Lingyin est aussi sale que des excréments ou de l’urine. » (FT, p. 206)
Des notes placées par l’auteur à la suite de ce chapitre précisent que la pollution s’explique par un taux de fluor surélevé ainsi que par la présence de substances dangereuses dont certaines ne sont pas identifiées : « l’air, le sol, la végétation étaient imprégnés de diverses toxines, cent vingt-six sortes peut-être, des toxines inconnues » (FT, p. 207). En fait, l’eau de la rivière est devenue à ce point souillée en raison de l’industrialisation de la ville de Luoyang : « La ville s’est développée, usines et bâtiments se sont rapidement étendus le long du cours supérieur (de la rivière), si bien qu’il n’y a plus ni oiseau ni poisson dans les eaux de Lingyin, rien que filaments gluants en surface, une sorte de soupe de nouilles, de la végétation croupissante… » (FT, p. 209)
Un autre exemple est celui de l’abattage des arbres, dans Le Rêve. Zhao Dequan alerte ainsi le grand père Ding Shuiyang :
En ce moment, toutes les familles (du village) sont en train d’abattre et de débiter des arbres. Même si ce n’est pas pour faire des cercueils, ils abattent les arbres. Tout le village est en train d’abattre les arbres. J’ai bien peur qu’au lever du soleil, il n’en reste pas un seul debout. Professeur Ding, il faut que tu fasses quelque chose. Sans les arbres, le village ne sera plus le Village des Ding. (RVD, p. 220)
Le résultat est ainsi décrit : finalement, « presque tous les grands arbres avaient été abattus. Il ne restait que les petits » (RVD, p. 278). Cet abattage est précisément lié à une décision politique, celle qu’ont prises Jia Genzhu et Ding Yuejing, les chefs du village, qui ont autorisé l’abattage d’un paulownia, puis d’un peuplier, puis d’un saule, etc. (voir RVD, p. 220, p. 222 et p. 223). Mais, cette décision est elle-même la conséquence de la contamination sanguine : l’augmentation du nombre de morts entraîne la nécessité de fabriquer des cercueils, qui conduit à abattre les arbres. Dans les deux exemples cités, la question environnementale est explicite, mais, dans Le Rêve, elle est une conséquence indirecte de la crise sanitaire.
Le plus souvent, la problématique environnementale est implicite. Ainsi, dans Les Jours, les Mois, les Années, on n’évoque ni explicitement ni indirectement une origine humaine à la catastrophe, présentée comme la combinaison de phénomènes naturels : la sécheresse et le vent. Mais on peut penser que ces phénomènes sont liés au réchauffement climatique, lui-même lié à la déforestation pratiquée pendant le Grand Bond en avant (1958-1960), ainsi que lors des premières réformes économiques de Deng Xiaoping (Dèng Xiăopíng 邓小平) (années 1980).
De même, la « maladie de la gorge obstruée », dont il est question dans La Fuite, semble implicitement liée à l’industrialisation au XXe siècle. Dans une des notes qui complètent le premier chapitre du livre I, elle est ainsi décrite : « [Les villageois] contractèrent d’abord la maladie des dents noires, celle des articulations, puis se retrouvèrent courbés, les os effrités, les membres déformés, jusqu’à la paralysie, étendus sur leurs lits. Depuis un siècle environ, c’est de la maladie de la gorge obstruée qu’ils meurent tous. Leur durée de vie est passé de soixante ans à cinquante puis à quarante, jusqu’à ce que finalement plus personne n’atteigne les quarante ans » (FT, p. 21).
Le débat environnemental est donc bien pris en charge par les romans, de façon explicite ou implicite, comme dans nos deux derniers exemples. Toutefois, il n’occupe pas une place centrale dans le dispositif narratif. En réalité, il s’agit le plus souvent d’une thématique incidente, présentée comme indissociable de deux autres thématiques : la catastrophe sanitaire et la gestion politique.
Pour développer ce discours à la fois écologique et, d’un point de vue plus large, politique, Yan Lianke recourt naturellement au registre satirique. Nous détaillons ci-après les divers procédés qu’il utilise, en commençant par les plus explicites, puis en tentant de révéler des moyens plus détournés auxquels le romancier doit recourir dans le contexte de censure et d’auto-censure de la Chine.
On repère tout d’abord des références historiques. Nous en comptons quatre dans La Fuite. Le roman décrit quarante ans de la vie d’un village dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui traverse successivement (en sens inverse de la chronologie) l’Ouverture en 1978 (voir FT, p. 312), l’aménagement des champs en terrasses dans les années 1960 (voir FT, p. 345), le Grand Bond en avant et la famine qui a suivi (« Ils sont allés fabriquer de l’acier ! », FT, p. 544 ; voir aussi la note explicative, p. 547), enfin la création des communes populaires à partir de 1958 (voir FT, p. 574-575).
Toutefois, la plupart du temps, Yan recourt à l’allusion, le procédé stylistique sans doute le plus attesté dans la tradition littéraire chinoise, qu’il s’agisse des deux figures bĭ (比) et xīng (兴), qui, dans la « Grande préface » au Classique des Poèmes, s’opposent à l’exposé direct (ou fù 赋), et de leurs dérivés comme le yĭnyù (隐喻, la métaphore, ou, plus littéralement, un « avertissement caché ») ou bien des allusions historiques ou littéraires proprement dites (jīgŭ 稽古ou yòngshì 用事) (voir Kao, 1986).
L’allusion est aussi le procédé obligé des poètes ou romanciers qui écrivent sous un régime de censure. Yan fait de nombreuses allusions générales à la Chine entendue comme entité politique. Le Village des Ding est situé « dans l’ancien lit du fleuve Jaune » (RVD, p. 36), ce qui fait de ce village une représentation de la Chine car le fleuve Jaune est traditionnellement considéré comme le « berceau de la civilisation chinoise ». Dans ce même roman, l’épisode du vol du cachet officiel renvoie au sceau impérial, symbole de l’État (voir RVD, p. 106 sq.). Le « Village des Trois-Patronymes », dans La Fuite, peut rappeler la période historique dite des Trois Royaumes (Sānguó 三国), pendant laquelle la Chine était divisée entre le Shu (Shŭ 蜀), le Wei (Wèi 魏) et le Wu (Wú 吴) (IIIe siècle après J.-C.). Par son caractère de généralité, ce type d’allusions ne fait qu’inviter le lecteur à entreprendre un travail herméneutique ouvert, sans qu’une piste interprétative soit précisément indiquée.
Il n’en est pas de même des allusions spécifiques, qui renvoient à un contexte historique plus précis. On a interprété la maladie de la gorge obstruée dont souffrent les habitants du Village des Trois-Patronymes dans La Fuite comme une « métaphore du bâillonnement idéologique » (Clavel, 2014) propre au régime communiste. Chien-hsin Tsai relève plus précisément les nombreuses allusions aux politiques mises en place par Mao Zedong (Máo Zédōng 毛泽东), en particulier lors de la Révolution culturelle : ainsi, les responsables de l’hôpital donnent aux villageois qui ont vendu leur peau un « livre en peau de couleur rouge » (hóngpí shū 红皮书), allusion limpide au « petit livre rouge » (hóngbăo shū 红宝书, voir Tsai, 2011a, p. 93-94). On pourrait encore évoquer de multiples allusions, comme la probable référence au projet de construction du Barrage des Trois-Gorges sur le Chang jiang (Cháng jiāng 长江, fleuve Bleu), à travers les travaux concernant le canal de Lingyin près du Village des Trois-Patronymes.
L’allusion est une figure du détour, qui consiste à substituer au terme propre (« le petit livre rouge ») un autre terme avec lequel il entretient un lien plus ou moins transparent (« le livre en peau rouge »). Le pastiche relève en revanche de l’imitation : il s’agit de reproduire un style, en l’occurrence celui de la propagande politique. Yan Lianke crée ainsi des slogans sur le modèle des mots d’ordre omniprésents dans la vie quotidienne des Chinois depuis l’époque de Mao. Ainsi, à l’entrée du Village des Trois-Patronymes, une banderole accueille les visiteurs en ces termes : « Aujourd’hui le paradis, demain une vie de centenaire. » (FT, p. 151). De même, le nouveau chef du village des Ding, un certain Gao, justifie par une formule la vente quasi forcée du sang : « développer la production de plasma pour le bonheur du peuple et la puissance du pays » (RVD, p. 32). Il faut comprendre le slogan suivant dans un contexte plus récent, celui qu’a créé la formule de Deng Xiaoping, reprise en partie du ministre libéral français Guizot, « Enrichissez-vous ! » (voir Viénet, 2007) : « C’est à vous de décider si vous voulez rester pauvres ou devenir riches. Ou bien vous choisissez la voie dorée qui vous mènera à la richesse, ou bien vous choisissez le pont vermoulu qui vous conduira vers la misère » (RVD, p. 37-38). Proche du slogan, l’inscription sur stèle (bēi 碑, voir Liu Xie, 1983, p. 126) renvoie au culte de la personnalité : « L’eau de Lingyin prolonge nos vies. / Sima Lan est notre bienfaiteur » (FT, p. 121). C’est par ce distique que l’on fait l’éloge de Sima Lan, qui est à l’initiative du canal de Lingyin. Yan imite encore les rapports officiels, où les énumérations font illusion. Ainsi, une fois le creusement du canal de Lingyin achevé, on insiste sur le caractère grandiose du projet : « Il a fallu trente mille mètres cubes de terre, cent dix mille mètres cubes de pierres, deux cent dix mille mètres cubes de mortier […] ». L’ironie est manifeste quand le texte du rapport se termine ainsi :
Dix-huit personnes ont péri — en plus des victimes de la gorge obstruée —, trente et une personnes se sont retrouvées infirmes. Tous ceux qui ont participé au chantier ont été blessés. Pour rassembler les fonds nécessaires aux travaux, cent quatre-vingt-sept villageois se sont rendus au dispensaire des grands brûlés et ont vendu sept pouces carrés de peau ; six en sont morts, neuf ont contracté une maladie grave. Sur les ordres de Sima Lan, Lan Sishi a conduit une trentaine de veuves et de femmes du village à Jiudu pour y faire commerce de chair ; onze ont attrapé une maladie […] (FT, p. 150-151)
Une semblable ironie se dégage de cet autre extrait de La Fuite, où Yan pastiche le « style statistique » des textes de planification économique, à propos du projet des champs en terrasses : « Des statistiques ont été établies : il a fallu trois ans à la famille de Lan Baisui — un homme et quelques femmes — pour renouveler cinq mus et deux fens de terre ; aussi, pour les champs de tout le village […] faudra-t-il probablement douze ans et trois mois… » (FT, p. 325). En calculant « de façon rationnelle » la durée nécessaire pour accomplir le projet, on en révèle ainsi le caractère totalement irrationnel.
Un autre procédé satirique consiste à détourner d’anciens mythes, à la façon de Lu Xun (Lŭ Xùn 鲁迅) dans son recueil Contes anciens à notre manière (Gŭshì xīnbiān 故事新编, voir Lou Sioun, 1936/1959). Ainsi, lorsqu’il prétend édifier un canal pour la communauté, Sima Lan (dans La Fuite) fait songer au « Grand Yu qui régule les eaux » (Dà Yŭ zhì shuĭ 大禹治水). De même, le vieillard des Jours luttant en vain avec une cravache contre le soleil rappelle le « Grand Yi qui décoche ses flèches sur (neuf) soleils » (Dà Yì shè rì 大羿射日) (voir Mathieu, 1989, n° 41, p. 99-100 et n° 47, p. 111). Toutefois, si l’archer mythique vient à bout de la sécheresse, le héros de Yan ne fait que produire un geste dérisoire : « [L’Aïeul] sortit de l’abri de nattes, prit la cravache qui se trouvait dans la cabane et visa le centre du soleil. Il donna une bonne dizaine de coups de fouet successifs, tournant sur lui-même, brisant les rayons dont les ombres tremblaient sur le sol » (Yan, 2002/2014b (par la suite JMA), p. 74-75 ; voir aussi une première occurrence de ce geste, p. 40-41).
Mais c’est surtout le mythe de la Source des fleurs de pêchers (Táohuā yuán 桃花源) que Yan Lianke retravaille, mythe rendu célèbre par le récit poétique qu’en fit Tao Yuanming (Táo Yuānmíng 陶渊明) au IVe siècle (voir Tao, 1990, p. 245-247). Dans La Fuite, le Village des Trois-Patronymes est présenté comme un lieu à part, à l’écart du reste du monde : « [L]e Village des Trois-Patronymes se trouve au plus profond de la chaîne montagneuse des Balou, [...], il est pareil à une zone d’épidémie, complètement coupé du reste du monde » (FT, p. 13). De plus, comme la rivière suivie par le pêcheur de Wuling (Wŭlíng 武陵) dans le mythe, le canal de Lingyin est censé conduire à ce monde à part. Mais Yan opère une inversion du mythe : les hommes de la source des fleurs de pêchers sont heureux parce qu’ils jouissent de tout ; dans le roman, les villageois isolés semblent voués à la souffrance tant physique que morale.
Dans Les Jours, après une longue et pénible marche, l’Aïeul atteint une source d’eau où il pourrait enfin étancher sa soif. De même que, dans le poème du Récit de la Source des fleurs de pêcher, le pêcheur passe par une « petite ouverture » (Tao, 1990, p. 245) dans la montagne et découvre un monde idéal, de même le vieillard suit un « ravin » qui va « en se rétrécissant », puis : « Levant la tête, la vision d’un paysage verdoyant le saisit. » (JMA, p. 77). Mais, à la différence du pêcheur qui retourne dans le monde des hommes ordinaires, de l’autre côté de la montagne, l’Aïeul est comme retenu prisonnier, car un loup, puis une meute de loups l’empêchent de quitter les lieux.
Dans Le Rêve, le mythe est également mis en scène lorsque les villageois visitent un village modèle, Shangyang, dans le district de Caixian (à 150 km de Weixian), qualifié de « paradis » : « Des deux côtés de la rue se dressaient des maisons d’un étage de style étranger aussi parfaitement alignées que sur un plan. [...] Dans toutes les maisons, le réfrigérateur se trouvait à gauche de la porte et le téléviseur était posé sur un meuble rouge devant le canapé […] » (RVD, p. 41-42). Il est clair que Yan se moque de la nouvelle société de consommation qui se met en place en Chine dans les années 2000. Ainsi le mythe de la Source des fleurs de pêcher est systématiquement inversé : au monde idéal que représente le village que découvre le pêcheur s’opposent des lieux de souffrance, de péril ou de bonheur factice.
1.2. Les cibles de la satire
Vers quelles cibles, au fond, est orienté ce propos satirique ? Le romancier vise moins des individus qu’un système, ou plutôt deux systèmes qu’il semble renvoyer dos à dos : l’ancien système collectiviste, mais utopiste et dictatorial, d’une part, et le nouveau système libéral qui se met en place au tournant des XXe et XXIe siècles.
Yan Lianke évoque les grands projets collectivistes qui ont marqué l’histoire de la Chine maoïste. Ainsi, dans Le Rêve, Jia Genzhu et Ding Yuejin, une fois qu’ils ont chassé le vieux Ding Shuiyang du pouvoir, énoncent les nouvelles règles de l’école — « Chaque malade devra fournir tous les mois à la collectivité sa contribution en céréales de bonne qualité […] » —, assorties de peines en cas d’infraction : « Quiconque trichera sur la quantité nique son arrière-grand-mère, et que toute sa famille meure de fièvre. » (RVD, p. 174-175). Dans La Fuite sont évoquées trois de ces entreprises de grande envergure censées annoncer des « lendemains qui chantent » : la création des champs de colza, puis l’aménagement des champs en terrasses (« retourner la terre »), enfin la construction du canal de Lingyin, « ouvrage grandiose qui permettrait d’amener les eaux bienfaitrices au village » (FT, p. 21). L’échec du canal est patent : « À leur retour du chantier, de nombreux morts, et dans le dernier cortège encore sept morts » (FT, p. 159), et il en est de même des autres projets (voir FT, p. 411 pour l’aménagement des champs en terrasses et p. 589 pour les champs de colza). Dans ce même roman, au livre IV, le romancier décrit sans concession les conséquences extrêmes d’un des gestes collectivistes les plus meurtriers du XXe siècle, le Grand Bond en avant : l’abandon d’enfants pratiqué à l’échelle individuelle, puis organisé par le système institutionnel, le cannibalisme, etc.
Outre leur caractère pour le moins irréaliste, ces politiques collectivistes reposent sur une logique de terreur qui s’exerce sur les individus. Ainsi, dans La Fuite, le chef Sima Lan, après avoir exposé sa décision de construire le canal, met en garde ceux qui ne lui obéiraient pas : « Après la moisson et les nouvelles semailles, on commencera les travaux du canal, et cette fois, celui qui voudra aller faire du commerce plutôt que de venir avec moi, je brûlerai sa maison ! » (FT, p. 93). Relayé par une armée qui lui est dévouée, il effraie la population :
Dans trois jours, nous commencerons les travaux du canal […]. Il parle fort, ses yeux, véritables lames de vent, cinglent les visages ; derrière lui, les jeunes, alignés telle une lisière de forêt, un bâton de saule ou de peuplier à la main, jaugent les villageois qui, effrayés par le regard de Sima Lan tout autant que par ces jeunes et leurs bâtons, ont cessé de respirer. (FT, p. 124)
Enfin, Yan Lianke révèle l’envers de l’idéal collectiviste : il s’agit en réalité d’une lutte pour le pouvoir ou pour un enrichissement personnel. Sima Lan (dans La Fuite) décide de réquisitionner les biens des habitants, en prétextant le bien commun, mais cette décision est assimilée à un simple « pillage » (FT, p. 126-127, voir aussi p. 235). Dans Le Rêve, la gestion de la crise sanitaire se voit détournée au profit d’un enrichissement individuel, essentiellement celui de Ding Hui (fils du grand-père Ding Shuiyang et père de l’enfant-narrateur). Le romancier dénonce ainsi le détournement de la visée collective vers la satisfaction des intérêts personnels8.
D’un autre côté, Yan Lianke dénonce clairement le nouvel ordre économique libéral qui a gagné la Chine depuis les années 1990 environ. Il condamne le règne du commerce et de l’argent, comme l’atteste ce propos livré à un périodique italien : « [L]a référence absolue est désormais l’argent »9 (cité dans Del Corona, 2013). Ainsi, dans Le Rêve, ce que vise Yan Lianke, c’est — en plus du pouvoir, représenté par Ding Hui, qui trompe la population — le consumérisme qui conduit les hommes à vendre leur sang : « Ma Xianglin [est] heureux d’avoir pu s’acheter une maison avec la vente de son sang » (RVD, p. 18). La course à la consommation concerne tout le monde : « À cette époque, quiconque avait de l’argent se faisait aussitôt construire dans cette rue une maison d’un étage » (RVD, p. 22). La vente du sang prend l’aspect d’un rite religieux, remplaçant les traditionnelles offrandes au dieu Guan (Guān Yŭ 关羽)10 censer apporter en retour un enrichissement matériel : « [Les villageois] avaient découvert une méthode plus efficace pour s’enrichir : plutôt que de faire confiance au dieu Guan, ils avaient préféré vendre leur sang » (RVD, p. 29).
Il devient clair dans le roman que la vente de sang, outre le fait qu’elle correspond à une réalité historique dont des milliers de Chinois ont été victimes, doit être interprétée comme le symbole du nouveau modèle économique et social qui prévaut en Chine, en raison du caractère habituellement sacré du sang humain : il faut comprendre en effet que les hommes transgressent un tabou en vendant jusqu’à leur propre sang. Du reste, parfois, comme dans cet extrait, le verbe vendre est employé de manière intransitive, ce qui est bien le signe qu’il s’agit d’une métaphore pour désigner la marchandisation généralisée des corps et des âmes. Après la visite du village modèle de Shangyang, les villageois du Village de Ding s’exclament : « Bordel de merde ! il faut vendre ! même si on doit en crever, il faut vendre ! » (RVD, p. 46)
Le motif de la vente se décline sous différentes modalités dans les romans de Yan Lianke, mais il est toujours appliqué à une notion à caractère sacrée. La vente des cercueils par Ding Hui prend, dans Le Rêve, le relais de la vente du sang. Cette nouvelle modalité est traitée dans le registre de l’humour noir, comme lorsque Ding Hui s’adresse à un villageois, client potentiel :
Tu le sais, au prix du marché, un cercueil vaut, au bas mot, cinq cents yuans mais je le vends seulement deux cents yuans aux gens du Village du Vieux-Fleuve.
Il réfléchit un bon moment avant d’ajouter :
— Pour ton frère qui est en phase terminale de la maladie, je te laisse un cercueil pour cent yuans. (RVD, p. 206)
Encore une autre manifestation de la logique mercantile, les mariages post mortem qu’organise le même Ding Hui, aux frais des survivants (voir RVD, p. 336 sqq.). Le modèle de l’économie financière est notamment tourné en dérision lorsqu’est décrit le fond du cercueil de Ding Qiang, l’enfant-narrateur, que son père, Ding Hui, entend marier post mortem à la fin du roman : « Le fond du cercueil sur lequel j’allais être couché était également décoré d’immeubles qui portaient tous le nom d’une grande banque : Banque de Chine, Banque de l’Agriculture, Banque du Commerce, Banque des Communications… Ainsi mon corps reposerait sur toute la richesse de la Chine et du monde » (RVD, p. 368).
Le motif de la vente se décline, dans La Fuite, avec la vente de la peau pour les hommes et la vente du corps (la prostitution) pour les femmes : Du Bai, le « représentant du gouvernement » (FT, p. 12), suggère ainsi à Sima Lu et Sima Hu d’aller vendre leur peau au dispensaire des grands brûlés (ouverts pendant la guerre sino-japonaise), afin de soigner, avec l’argent récolté, leur frère aîné Sima Lan (voir FT, p. 18 ; voir aussi livre II, chap. VII en entier, puis livre III, chap. I, p. 330 sqq.) tandis qu’il est demandé à Lan Sishi de se prostituer en ville, avec l’expression « aller faire commerce de chair », pour pouvoir guérir Sima Lan, le chef du village (voir FT, p. 48). Les deux modalités (vente de peau et « commerce de chair ») sont explicitement mises en parallèle : Lan Sishi « se met en route » pour la ville, « pareillement à ces hommes qui vont vendre leur peau au dispensaire des grands brûlés » (FT, p. 56-57).
De façon plus marginale, la satire peut aussi porter au-delà de la Chine proprement dite : elle vise par exemple, dans La Fuite, les représentants de l’ONU, qui ont bien constaté les problèmes environnementaux mais n’ont rien dit, se contentant de secouer la tête : « Des années auparavant, les compagnons d’Occident venus passer une quinzaine de jours au village ne disaient jamais rien, mais secouaient continuellement la tête » (FT, p. 208). L’instance internationale que représente l’ONU est ainsi désignée comme la complice d’une politique libérale aux conséquences meurtrières pour la population chinoise.
Qu’il s’agisse du système collectiviste ou du système libéral, la critique exprimée par Yan Lianke prend le plus souvent un caractère moral. D’un côté, il dénonce la poursuite des intérêts individuels derrière le masque de programmes politiques prétendument destinés à la collectivité ; de l’autre, il associe l’économie libérale à une transgression vis-à-vis des notions sacrées que représentent le sang, la peau et la « chair ». Yan dresse en fait le constat d’une crise morale : « [M]on pays a perdu la morale traditionnelle sans en avoir établi une nouvelle »11 (cité dans Del Corona, 2013).
On a l’impression, dans Le Rêve, que l’immoralité des dirigeants entraîne celle des autres membres de la population. Elle est d’abord associée à Gao, puis relayée par Ding Shuiyang, pour la vente de sang, et s’étend ensuite à Ding Hui pour la vente des cercueils, puis toute la population semble concernée, avec les voleurs (voir l’épisode du vol du cachet officiel : RVD, p. 106 sqq.), les tricheurs (comme ceux qui remplacent le riz par des briques dans les sacs qu’il faut fournir à l’école, voir RVD, p. 149), etc. Ainsi, à l’épidémie physique se superpose une contamination morale ou spirituelle, qui s’inscrit dans la pensée politique traditionnelle chinoise, où le détenteur du pouvoir doit incarner la vertu par excellence (dé 德) qui se propage alors sur l’ensemble de la population, mais où, à l’inverse, un comportement déviant de la part du souverain entraîne inévitablement le désordre parmi les hommes, ainsi que l’affirme Confucius à un de ses disciples, en recourant à la métaphore du vent (fēng 风) : « Si vous cherchez à être bon, le peuple sera bon. L’homme de bien a la vertu du vent, l’homme de peu, la vertu de l’herbe. Sous le souffle du vent, l’herbe ne peut que se courber »12 (Le Blanc & Mathieu, 2009, p. 143).
2. Sous le signe de l’obtus : mesurer l’ordre et le désordre entre l’homme et la nature
La satire politique est liée à l’action de l’homme sur l’homme, et, comme nous l’avons vu, la nature, du fait de cette action intra-humaine, peut en subir les conséquences. Mais Yan Lianke envisage aussi, de façon secrète, voire peu consciente, un lien plus direct et fondamental entre l’homme et la nature, non plus sur le plan politique, mais sur un plan philosophique. Il sort, pourrait-on dire, l’homme de la sphère proprement et limitativement humaine, pour le replacer dans un « univers » plus large, dont les deux pôles sont la « terre » et le « ciel ». En chinois, en effet, les deux termes joints, ciel-terre (tiāndì 天地), désignent le « monde », l’« univers » ou encore le « cosmos ». S’appuyant, pour penser les rapports entre l’homme et la nature, sur la triade (sānjí 三极) de la tradition philosophique chinoise, constituée de la terre (dì 地), du ciel (tiān 天) et de l’homme (rén 人), Yan semble bien illustrer dans ses romans l’idée selon laquelle l’homme, situé entre le ciel et la terre, peut contribuer, par son action, à l’ordre ou au désordre du cosmos.
Comme le formule le classique confucéen appelé Zhōngyōng (中庸, L’Invariable Milieu ou La Pratique équilibrée), la destination ou l’accomplissement de l’homme consiste en effet à s’intégrer dans le lien dynamique qui unit le ciel et la terre :
Ayant atteint les limites de sa propre nature, [l’homme] est à même d’atteindre les limites de la nature des autres hommes ; les ayant atteintes, il est à même d’atteindre les limites de tous les autres êtres ; les ayant atteintes, il peut assister le ciel et la terre dans leurs processus de transformation-croissance ; les ayant assistés, il peut former un trio avec le ciel et la terre. (Le Blanc & Mathieu, 2009, p. 591)
Or, on peut considérer que la terre et le ciel, tels qu’ils sont compris dans la tradition philosophique chinoise, correspondent aux deux aspects de ce que l’on désigne, en Occident, par le terme de nature. En effet, la « terre » correspond à la nature entendue comme l’espace naturel dans lequel se situe l’homme, en particulier la « terre cultivable »13, comme l’indique le Dictionnaire Ricci des caractères chinois, c’est-à-dire l’environnement premier dans la société chinoise traditionnelle fondée sur l’agriculture. Le « ciel » désigne « la totalité du mouvement de la vie et de ses lois »14, ce que, grosso modo, la tradition philosophique grecque nomme phusis. Pour être plus précis, tiān (le « ciel ») désigne à l’origine une divinité suprême, puis, à partir de la dynastie royale des Zhou (XIVe-VIIe siècles avant J.-C.), le sens du mot évolue pour renvoyer à une notion plus abstraite : le ciel est entendu comme le principe régulateur des phénomènes observés dans la réalité (voir Cheng, 1997, p. 41-53). Pour reprendre la définition du Dictionnaire Ricci, il s’agit de « la totalité du mouvement de la vie », mais en lien avec « [l]es lois » qui le régissent. Le ciel désigne donc le lien dynamique qui unit les phénomènes naturels concrets (qu’ils opèrent dans la nature au sens de l’environnement naturel ou dans une autre sphère de la réalité, comme dans la sphère morale) et une force supérieure (mais pas nécessairement transcendante), qui en est le principe : il « finit par se confondre avec le naturel » (Cheng, 1997, p. 53).
Au-delà d’une logique intra-humaine qui donne lieu à un discours satirique et, partant, politique, tout se passe donc comme si Yan Lianke s’employait à replacer l’homme dans le complexe ciel-terre, s’inscrivant davantage dans une logique philosophique. Il s’agit, en définitive, non pas tant de dénoncer les atteintes à la nature que de mesurer l’ordre et le désordre qui caractérisent le rapport de l’homme avec la « terre » et le « ciel ».
Mais cet aspect philosophique de la conception de la nature par Yan Lianke, que notre analyse va tenter de mettre en lumière, ne résulte pas d’un processus nécessairement conscient et maîtrisé : c’est pourquoi nous proposons de le placer sous le signe de l’obtus. Il s’agit moins d’un discours « intentionnel », comme l’est le discours satirique que nous avons étudié dans un premier temps, que d’une conception qui « vient “en trop”, comme un supplément que [l’]intellection ne parvient pas bien à absorber, à la fois têtu et fuyant, lisse et échappé » (Barthes, 1970/1982, p. 45).
2.1. L’homme et la « nature-terre » : continuité et rupture
L’homme est tout d’abord replacé dans l’environnement qui constitue son horizon naturel, ou, pour être plus précis, dans le mode de vie rural qui caractérise la civilisation chinoise traditionnelle. Yan Lianke dresse deux constats qui semblent s’opposer l’un à l’autre : d’une part il rétablit l’homme dans le lien qui l’unit avec la « terre », traçant ainsi une continuité fondamentale entre la sphère humaine et celle de la nature ; d’autre part, il relève au contraire les signes d’une rupture entre l’homme et la nature, traduisant alors le désordre ou le déséquilibre au sein de la triade constituée de la terre, du ciel et de l’homme.
Le procédé quasi systématiquement employé par le romancier pour replacer l’homme dans la « nature-terre » est la comparaison, dont le fonctionnement et les contenus sont empruntés à la longue tradition poétique chinoise. La nature à laquelle l’homme est comparé, pourrait être qualifiée de neutre dans les exemples suivants, que nous empruntons à La Fuite, où le romancier décrit le sentiment de la tristesse : « L’immense tristesse [de Sima Lan voyant les villageois abandonner le projet du canal] [est] pareille à l’infinie chaîne montagneuse noyée de vent et de brouillard » (FT, p. 308). De même, les plaintes de Lan Sishi, au moment où Sima Lan la violente, sont comparées à de « fines lamelles d’écorce de saule » (FT, p. 374) ; celles de Lan Sishi, au bruit d’un cours d’eau : « [Lan Sishi] sanglote doucement, faiblement, comme l’eau murmure » (FT, p. 107).
Ainsi les sentiments éprouvés par les hommes et les femmes semblent s’inscrire dans une logique qui déborde la sphère proprement humaine, unissant de la sorte l’homme à la nature. Mais ce sont les hommes et les femmes eux-mêmes qui semblent se confondre avec la nature lorsque le romancier utilise la comparaison pour décrire un visage. Ainsi celui de Sima Taohua, la mère de Du Zhucui, au moment où elle conseille à Sima Lan d’offrir Lan Sishi au responsable Lu, pour qu’il continue à superviser les travaux du village, dont « les coins des yeux ridés » ressemblent à « des sillons pareils à ceux que la charrue creuse dans la terre » (FT, p. 382). De même le visage « blême » de Teng, la fille de Sima Lan, est « pareil à une boule de nuages figée là » (FT, p. 79).
Certains comparaisons, fort nombreuses, tirent l’homme du côté d’une nature violente, comme pour caractériser une envie de meurtre : « L’idée [dans l’esprit de Sima Lan, de tuer sa femme Du Zhucui] croît frénétiquement comme pousse l’herbe sauvage sur un tas de fumier après la pluie » (FT, p. 100) ; le romancier ajoute, une page plus loin : « l’idée de la tuer […] a pris racine en lui exactement comme une graine. […] L’idée afflue de nouveau, le submerge — torrent sombre et impétueux, grouillant, éboulant des pierres à son oreille » (FT, p. 100).
La violence peut être celle d’un sentiment individuel, comme dans l’exemple précédent, mais elle peut aussi concerner un phénomène collectif, comme la prolifération de la maladie dans Le Rêve : « Tel un vol de criquets, la maladie s’abattait sur tous les villages » (RDV, p. 11), ou « la maladie allait exploser dans toute la plaine et, comme le Fleuve Jaune rompant ses digues, allait inonder le Village des Ding » (RDV, p. 14).
La nature qui sert de comparant aux personnages renvoie souvent au principe de vitalité qui caractérise en fait l’homme comme tout être naturel. À la faveur des comparaisons, le corps humain s’inscrit dans le « mouvement de la vie » qui définit la nature : « Le corps bien droit de Sima Lan [est] pareil au plant de maïs qui se redresse après un coup de vent. » (FT, p. 46). Le romancier décline cette comparaison dans un registre qui peut être encore plus trivial : quand un jeune homme retrouve sa « promise », la chair de celle-ci est « aussi lisse qu’un navet qu’on vient d’éplucher » (FT, p. 189). De même, les divers aspects que peut prendre un visage heureux font écho aux beautés de la nature printanière ou, dans le dernier exemple, estivale : « [L]es yeux [de Sima Lan revenant « guéri » de l’hôpital] brillent vivement : deux prairies ensoleillées au fin fond de la montagne, par un jour de mars » (FT, p. 93) ; « le premier sourire qu[e Lan Sishi] adresse [à sa mère], parfaitement silencieux, est comme une fleur pourpre qui s’épanouit sur ses tendres lèvres » (FT, p. 595) ; « on croirait voir des fleurs de colza tomber sur [le] visage [de Lan Sishi, lorsqu’elle connaît sa première expérience érotique avec Sima Lan] » (FT, p. 448).
Toutefois, plus souvent encore, la nature à laquelle est comparé l’homme dans les romans est celle de l’automne et de l’hiver, une nature gagnée par la mort. Yan exploite à ce titre le motif de la feuille morte qui sert de comparant tantôt au visage ou au regard, tantôt aux plaintes des personnages. Au moment terrible où, dans La Fuite, pressés par la famine, les hommes abandonnent les enfants infirmes à la mort, « [l]e visage de la jeune femme [Sima Taohua], [devient] à l’instant blême tel une feuille de givre » (FT, p. 588). De même, au moment de la prise de pouvoir de Sima Lan et de Du Yan, les yeux des villageois sont comparés « aux feuilles mortes tourbillonnant dans le vent » (FT, p. 221). Enfin, la souffrance physique et peut-être aussi morale des hommes qui ont vendu leur peau est ainsi décrite : « Jusqu’à minuit tourbillonnent, telles des feuilles mortes, les plaintes des blessés » (FT, p. 289) ; parallèlement, « [l]es soupirs des femmes chutent en voltigeant comme autant de feuilles mortes venues tapisser le sol, couche après couche » (FT, p. 405). Le motif est encore repérable dans Le Rêve : « les villageois [...] quittaient ce monde comme les feuilles mortes que le vent fait tomber des arbres à l’automne » (RVD, p. 8) ; « [t]elles les feuilles d’un vieil arbre, les gens se flétriraient, jauniraient, tomberaient et une bourrasque de vent les emporterait à jamais » (RVD, p. 14), etc.
Une étude systématique des comparaisons révèlerait certainement que les images qui servent à décrire les hommes se partagent le plus souvent entre deux qualités opposées, mais toutes deux renvoyant à la mort : le sec et l’aqueux. Le sec est déjà ce qui caractérise le motif de la feuille morte. Mais il peut s’appliquer à la peau d’un fruit, à l’aspect de l’herbe, aux pétales d’une fleur ou encore à une branche d’arbre. Ainsi, les yeux de Sima Lan, après sa visite à Lan Sishi qui s’est d’abord refusée à lui, puis s’est déshabillée par provocation, sont « secs comme la peau du kaki après une nuit d’insomnie » (FT, p. 119) ; « [le] regard [de Sima Lan] semble dépérir, pareil aux herbes sèches assoiffées de pluie et de lumière en pleine hiver » (FT, p. 19) ; au moment où son cousin Sima Lan va vendre sa peau et acquérir un statut héroïque, Du Bai « rumine car derrière lui s’effeuille sa pensée — pétales de fleur noire et flétrie » (FT, p. 337 ; notons que, dans cet exemple, le comparé n’est plus un élément matériel — visage, regard, mains, etc. — mais la pensée du personnage) ; « [l]es mains de [Sima] Lan sont restées figées, aussi rigides que deux branches de cédrel desséchées » (FT, p. 39) ; Zhucui, la femme de Sima Lan est « aussi maigre qu’une branchette cueillie sur un versant des Balou, qu’un orme ou un sophora desséché » (FT, p. 78).
L’aspect aqueux est moins fréquent, mais, quand il est associé à l’absence de mouvement (contrairement à l’image du cours d’eau que nous avons rencontrée), il est également un signe de mort. Lorsque, dans La Fuite, les efforts pour « retourner la terre » se sont soldés par un échec, qu’il est alors demandé d’envoyer auprès du « responsable Lu », comme un tribut, une vierge, et que les villageois désignent Lan Sanjiu, sa fille, le chef du village Lan Baisui tente de prendre la parole : « [s]a voix est une eau dont le cours s’est figé, tantôt bourbeuse, tantôt cristalline » (FT, p. 395) ; la même image qui décrit la parole s’applique au silence (immatériel) des femmes qui ont appris qu’en leur absence les hommes se sont débarrassés des enfants infirmes : « [l]e silence [des femmes] s’étend infiniment, fleuve immobile dénué de cours, dans les eaux duquel elles meurent » (FT, p. 509).
Nous avons utilisé le terme de comparaison pour désigner le procédé consistant à relier certains aspects ou certaines activités humaines à la nature. Mais il ne s’agit pas du procédé rhétorique qui consiste, sur le mode de la superposition, à rapprocher deux univers (ou isotopes, voir Groupe µ, chap. I) a priori distincts l’un de l’autre, car l’univers de l’homme et celui de la « terre » sont conçus en continuité l’un avec l’autre : par ses multiples « comparaisons », Yan Lianke rétablit cette continuité dans un geste qui consiste non à superposer l’univers naturel à l’univers humain (qui seraient alors conçus comme distincts l’un de l’autre), mais à replacer l’homme dans l’univers naturel auquel il appartient, à englober l’homme dans la « nature-terre », conformément à l’usage du procédé appelé xīng (兴) dans l’ancienne poésie.
Cette idée est particulièrement sensible à travers le motif des animaux dans les romans. Les personnages humains sont parfois effectivement comparés à des animaux : ainsi le vieux Lan Baisui, le chef du Village des Trois-Patronymes dans La Fuite, « ressemble à un vieux mouton faible, incapable désormais de conduire son troupeau sur les monts » (FT, p. 389). Comparaison également dans le passage suivant : « Elle [Zhucui, la femme de Sima Lan] près de lui [Sima Lan] pour se rendre dans la cuisine : une poule qui lui aurait échappé des mains. [...] Puis il se jette sur elle. Mais Zhucui a anticipé ; elle l’esquive et s’enfuit tel un moineau » (FT, p. 104-106). Il semble en l’occurrence que les personnages se transforment en animaux, comme dans certains récits surnaturels de la tradition chinoise (mais aussi indienne et arabe, puisque le motif de la transformation de l’homme en animal dans le contexte d’une lutte est bien présent dans des classiques comme Le Ramayana ou Les mille et une Nuits). En réalité, hommes et animaux sont liés les uns aux autres par le principe de la transformation à l’œuvre dans tout être vivant (voir par exemple le cycle des transformations dans le Zhuangzi, dans Grynpas & Liou, 1969, p. 219).
Lorsque, dans d’autres passages, le romancier ne recourt pas à la comparaison pour associer les hommes et les animaux dans un même univers, la logique est en fait la même : il s’agit de suggérer ou de représenter la continuité fondamentale qui unit les êtres vivants, hommes ou animaux, dans la nature, en référence au principe de transformation. Cela est particulièrement bien illustré par la relation entre l’Aïeul et le chien dans Les Jours. Ainsi, lorsque le chien aide l’Aïeul à préserver la vie du pied de maïs malgré la sécheresse, l’Aïeul en vient à envisager que, dans sa prochaine vie, il renaisse sous l’aspect de son chien et inversement : « si je dois me réincarner en animal dans ma prochaine vie, je me réincarnerai en toi, et toi, si tu dois te réincarner en homme, tu seras mon enfant » (JMA, p. 108). Le principe de transformation est ici décliné dans le cadre de la doctrine bouddhique de la renaissance.
Ainsi, la comparaison pratiquée par Yan Lianke pour associer l’homme et la nature, plus qu’un procédé rhétorique, renvoie à une vision du monde où l’homme est replacé dans un rapport de continuité avec la « nature-terre » entendue comme son environnement naturel immédiat, et où peut jouer le principe de la transformation universelle des êtres vivants.
Toutefois, cette intégration de l’homme dans la nature semble s’opposer au constat, tout aussi manifeste à la lecture des romans, selon lequel ce lien a été rompu. En effet, Yan Lianke montre que les atteintes faites par l’homme à la nature reçoivent une réponse immédiate de la nature même. Lorsque les villageois de La Fuite, conformément aux directives politiques, retournent la terre pour faire des champs en terrasses, la terre semble souffrir : « Les pioches s’enfoncent dans la montagne millénaire qui s’est mise à frissonner. Sa chair rouge exhale un souffle dense et fougueux, mêlée d’une tiédeur sèche ou croupie, jaillie sous les coups de pelles et de pioches. [...] Les moineaux, effrayés, s’envolent sans plus savoir où se poser. » (FT, p. 343). Le romancier multiplie ainsi les « réponses » de la nature au mal que lui infligent les hommes. Dans Le Rêve, une fois que la vente du sang a commencé, le désordre se manifeste, formulé exactement comme dans la tradition littéraire des « récits d’anomalies » (zhìguài 志怪) : « Bien qu’on fût au printemps, les feuilles des arbres, à respirer le sang, se teintaient de rouge… » (RVD, p. 48). De même, dans La Fuite, après que s’est répandue la nouvelle des sept morts du dernier cortège revenant du chantier du canal, « [s]ous le coup des sanglots répercutés, les arbres se dénudent, leurs feuilles [sont] emportées en tourbillon. La douceur odorante des champs cultivés est chassée et le paysage se réduit à une succession de tristes ravins » (FT, p. 164).
Au fur et à mesure des atteintes portées par les hommes à la nature, la « réponse » de celle-ci prend des proportions de plus en plus impressionnantes. Ainsi, une fois que la pollution de l’eau est effective, c’est l’environnement tout entier qui semble s’exprimer : « Le vent cesse. [...] La chaîne silencieuse des Balou se met à vibrer, la dure ligne de crête à trembler [...]. La poussière s’amalgame et chauffe. C’est l’aube et l’air devrait être frais, mais la montagne entière se meut et l’atmosphère se fait lourde et sombre » (FT, p. 190). Jusqu’au moment où il semble que le cosmos, le « ciel-terre », soit sur le point de basculer dans le chaos : « Le soleil est au zénith, la coupe d’or ressemble maintenant à une courge fort mûre, suspendue à son aise dans le ciel. À bien la regarder, Sima Hu [frère cadet de Sima Lan] la voit osciller, lourde et prête à tomber à tout moment, dans un fracas éclatant » (FT, p. 197).
Ces « réponses » de la nature se manifestent bien au niveau de la « terre », mais, selon un mode de représentation traditionnel en Chine, ce sont les réponses du « ciel ». En effet, un adage apparu dans le contexte d’un renouvellement de la pensée sous la dynastie des Han antérieurs (206-25 avant J.-C.) (voir Cheng, 1997, p. 277-306), mais intégré par la suite dans la culture à la fois populaire et philosophique, veut que « le ciel et la terre se répondent » (tiānrén gănyìng 天人感应) : tant que l’homme se conforme à l’ordre naturel, l’équilibre de l’univers est préservé, mais si l’homme opère un écart par rapport à l’ordre naturel, alors cette action transgressive trouvera sa « réponse » ou sa « résonance » (gănyìng 感应) dans des phénomènes naturels tels qu’un tremblement de terre ou un épisode de sécheresse. Cette réponse est celle que le ciel adresse à l’homme, mais elle se manifeste bien par des signes visibles au niveau humain, c’est-à-dire sur « terre ». Ainsi, le lien entre l’homme et la nature est traditionnellement conçu comme un dialogue entre l’homme et le ciel : les calamités et les prodiges sont « présentés comme autant d’avertissements et de sanctions célestes « répondant » (yìng 应) aux dérèglements du monde humains » (voir Cheng, 1997, p. 292, à propos de la notion de « résonance », développée par Dong Zhongshu (Dŏng Zhòngshū 董仲舒), c. 195-115).
2.2. L’homme et la « nature-ciel » : désordre et ordre
À ce dialogue entre l’homme d’une part et le ciel qui lui répond d’autre part s’ajoute une logique dialectique en vertu de laquelle le désordre qui résulte de la rupture entre l’homme et la nature et que l’on constate à travers les signes manifestés par le ciel au niveau de la terre, se renverse en ordre, à condition de se situer au niveau non plus de la terre mais du ciel. En effet, Yan Lianke recourt à des références canoniques pour suggérer qu’il existe un principe de régulation, que la tradition nomme ciel, et dont la fonction est de garantir l’ordre quoi qu’il arrive, si bien que le désordre, que nous avons interprété comme un signe de rupture entre l’homme et la nature dans une perspective terrestre, doit être réinterprété comme le signe d’un ordre supérieur dans une perspective céleste : il s’agit d’une étape nécessaire pour rétablir l’équilibre, ou, plus exactement, pour recommencer, coûte que coûte, un nouveau cycle de vie. Dans ses romans, Yan propose en effet un « modèle » implicite selon lequel le désordre, c’est-à-dire les souffrances injustifiables que subissent les hommes, sont en définitive justifiées dans une logique cyclique, car elles constituent la voie ouverte vers un renouveau possible.
Avant de préciser concrètement le fonctionnement de ce modèle implicite à l’œuvre dans les trois romans qui nous occupent, nous replacerons la démarche de Yan Lianke dans la perspective « mythoréaliste » qu’il développe dans À la découverte du roman (Fāxiàn xiăoshuō 发现小说, 2011), un essai critique paru récemment en français (2017), traduit par notre regrettée Sylvie Gentil, à qui nous devons tant de traductions de la littérature chinoise contemporaine.
Par le mot mythoréalisme (shénshízhŭyì 神实主义), Yan Lianke désigne une nouvelle forme d’écriture romanesque qu’il appelle de ses voeux, et qui constituerait un dépassement par rapport aux propositions anciennes que constituent quatre formes romanesques du passé : le roman de propagande, qualifié de « fallacieux » et associé aux régimes autoritaires, voire « totalitaire[s] » (Yan 2011/2017, p. 10) ; le roman traditionnel, tant occidental que chinois, caractérisé par la « causalité absolue », où les actions des personnages sont toutes imputables à une rationalité objective et collective ; enfin deux formes de roman du XXe siècle qui ont tenté de rompre avec ce dernier modèle : le roman selon Kafka, caractérisé par la « causalité zéro », où le fait initial (comme la métamorphose de Gregor Samsa en insecte) échappe à toute rationalité (c’est un « c’est pourquoi » privé de « parce que »), et le roman relevant du « réalisme magique », caractérisé par une « semi-causalité », où certains faits sont expliqués par une cause objectivement irrationnelle mais culturellement acceptable (comme le fait de naître avec une queue de cochon rapporté à l’inceste commis entre Ursula et José Arcadio Buendia dans Cent ans de solitude). Le roman mythoréaliste reposerait sur une « causalité interne » définie en ces termes : « Cette causalité interne correspond à un nouveau rapport logique qui n’est ni la causalité absolue, ni la causalité zéro, ni la semi-causalité. À la fois cause originelle et aboutissement, elle fait évoluer les personnages et l’intrigue en se fondant sur leur réalité intérieure, jamais à partir d’un facteur issu du monde extérieur (la société, l’environnement, les autres…) » (Yan 2011/2017, p. 143).
Yan Lianke semble distinguer plusieurs modes de causalité interne. Les deux premières, associées à Kafka d’une part et à Virginia Woolf d’autre part, ne concernent pas le mythoréalisme : dans le cas du premier, la cause est à la fois interne et innommée (en cela, elle relève de la « causalité zéro ») ; pour Woolf, la cause est de nature psychologique et individuelle (p. 140-141). La causalité interne en jeu dans l’écriture mythoréaliste n’est pas une causalité individuelle de type psychologique15 ni une causalité zéro ; il s’agit d’une causalité collective, émanant d’un « réel interne, commun à toute l’humanité sur les plans collectif, social et psychologique »16 (p. 144-145) Il faut comprendre que ce « réel interne » est de l’ordre de l’« invisible » et appelle, de la part du romancier, une démarche exploratoire : l’écrivain mythoréaliste « se met en quête d’un réel interne qui, parce qu’il repose sur la causalité interne, pénètre au plus profond des hommes, de la société, de l’histoire et de l’univers, lui permettant de peindre un réel recréé, étroitement lié à l’expérience mais invisible au point de donner l’impression de ne pas exister » (p. 162).
Pour entreprendre cette quête du « réel interne », le romancier peut suivre les « canaux que constituent les diverses formes de l’imaginaire, les allégories, mythes, légendes, rêves, fantasmes et abstractions issus du quotidien et de la réalité sociale » (p. 162). Tous les moyens ainsi énumérés dont dispose le romancier pour atteindre le réel « invisible » sont regroupés dans la première partie du mot-valise mythoréalisme forgé par Yan, la seconde renvoyant au « réel »17. Le roman mythoréaliste est donc un récit qui s’appuie sur des « mythes » — mot entendu dans un sens très large —, pour non pas représenter le réel externe selon une logique ancienne, mais « explorer » ou « fouiller la réalité », ou bien encore « interroger l’homme et la société » (p. 164), afin d’atteindre le réel invisible.
C’est à l’intérieur de ce cadre méthodologique, défini sans doute a posteriori par Yan Lianke, que nous nous proposons dans un dernier temps de reconstituer le modèle « mythoréaliste » à l’œuvre dans ses trois romans, modèle dialectique selon lequel le ciel, entendu comme un principe régulateur supérieur, garantit l’ordre au-delà des apparences du désordre.
Nous verrons tout d’abord que le matériau mythique sur lequel s’appuie le romancier pour « élaborer » ce modèle est constitué de références canoniques, conformément aux exemples qu’il cite dans son essai critique pour illustrer les « mythes » auxquels peut emprunter le roman : il évoque la Bible ainsi qu’Homère et La Pérégrination vers l’Ouest (Xīyŏu jì 西游记), un des romans les plus célèbres de la tradition chinoise (voir Yan 2011/2017, p. 178-179). Puis nous détaillerons le fonctionnement du modèle, qui se caractérise par une logique cyclique où la part d’ombre constituée de figures sacrificielles doit se comprendre comme l’envers d’un pôle de lumière associé au principe vital.
C’est essentiellement au seuil des romans, non pas dans le péritexte proprement dit, mais dans les épigraphes — une sorte de seuil interne — que Yan Lianke formule l’idée selon laquelle un ordre supérieur préside aux destinées humaines. Cette place, en tête du roman tout entier pour Le Rêve du Village des Ding ou des chapitres pour La Fuite du temps, confère au propos développé une sorte de statut d’autorité, à la façon des poèmes introductifs dans la tradition romanesque chinoise, où est explicitée la visée morale que le roman est censé illustrer. Ces épigraphes contiennent en effet des références canoniques faites soit à la tradition bouddhique soit à la Bible. Or, ces références semblent bien exprimer l’idée selon laquelle la souffrance que les hommes peuvent connaître sur terre doit en définitive être acceptée car, selon la doctrine bouddhique, cette souffrance n’est en fait qu’illusion, ou bien, si l’on suit les citations bibliques, parce qu’elle constitue une épreuve qu’il faut savoir replacer dans un dessein divin.
Les chapitres des livres impairs (I, III et V) de La Fuite citent des paroles de Bouddha adressées au maître Dahui18. Le texte qui ouvre le premier livre fait valoir la notion bouddhique d’impermanence et d’illusion : « Bouddha dit : Maître Dahui ! Tous les êtres de ce monde craignent profondément les douleurs de la vie et de la mort et aspirent au nirvāṇa. Ils ne savent guère que la frontière entre la vie et la mort n’est que métamorphose d’une seule et même nature, que toute différence est illusoire et qu’il n’existe en fait ni forme ni nature propre » (FT, p. 7). La souffrance, traduite dans le texte par les « douleurs de la vie et de la mort » est ce qui motive certains hommes à désirer se fondre dans le grand vide appelé nirvāṇa, qui désigne en fait précisément l’état de non-désir permettant de sortir du cycle des renaissances. Or, ce texte rappelle qu’une telle disposition est en contradiction avec le principe selon lequel tout, qu’il s’agisse de la vie ou de la mort, de la souffrance ou de la joie, relève de l’impermanence (« métamorphose »), c’est-à-dire, en dernier ressort, de l’illusion (ou vacuité). Aussi est-il vain, en effet, de vouloir fuir la souffrance que l’on croit connaître dans le monde de poussière dans lequel nous vivons.
L’ouverture du livre V, qui cite à nouveau le maître Dahui, va dans le même sens que celle du premier livre : « Les hommes [...] ignorent que vie et mort ne sont qu’illusions » (FT, p. 549). L’ouverture du livre III répète la même idée, mais évoque plus explicitement la notion de souffrance, qui est considérée comme la première des « quatre nobles vérités » dans la doctrine bouddhique19 : « [Les hommes] croient [à tort] que le monde né dans leurs esprits existe bel et bien à l’extérieur, c’est pourquoi ils ne cessent de souffrir vie et mort » (FT, p. 317).
Le thème de la souffrance humaine est également celui qui est abordé dans les épigraphes des chapitres des livres II et IV de La Fuite, mais la souffrance est alors associée à l’idée d’une épreuve à laquelle les hommes sont soumis selon un plan divin qui leur échappe. Les chapitres du livre II citent le début de l’Apocalypse attribuée à Jean de Patmos20 où le Christ s’adresse à Jean pour qu’il écrive des lettres (épîtres) aux sept églises d’Asie (Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée). Ces épigraphes commencent par un rappel à l’ordre que le Christ adresse aux hommes qui ont péché : « [J]’ai contre toi, dit le Christ, que tu t’es relâché de ton premier amour. Rappelle-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi et reprends tes premières œuvres » (FT, p. 213). Puis elles évoquent l’idée d’une épreuve à laquelle est soumis le fidèle, auquel on fait valoir la promesse d’une vie après la mort, à l’image du Christ ressuscité : « [V]oici ce que dit le Premier et le Dernier, celui qui a connu la mort et repris vie : [...] Ne redoute pas ce que tu vas souffrir ; le diable en effet va jeter quelques-uns des vôtres en prison pour que vous soyez mis à l’épreuve, et vous aurez une tribulation de dix jours. Montre-toi fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de Vie » (FT, p. 233, et Apocalypse, 2 :8-11). Quelques chapitres plus loin, une épigraphe assure en revanche qu’au moment voulu, Dieu épargnera les siens : « [J]e te garderai de l’heure de l’épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la Terre » (FT, p. 264). Le romancier semble donc bien admettre l’existence d’un ordre supérieur (Dieu de la tradition judéo-chrétienne ou le ciel de la tradition chinoise) qui rétribue les hommes à la mesure de leurs actes.
Le livre IV distribue de chapitre en chapitre des citations de l’Exode et des Nombres21 : les épigraphes relatent donc la sortie d’Égypte, la traversée de la mer Rouge et des déserts, avec l’épisode de la manne, jusqu’au désert de Paran (Pharan dans le texte), puis l’arrivée aux abords du pays de Canaan, le « pays où coulent le lait et le miel ». En parallèle au récit des villageois du village des Trois-Patronymes, guidés par des hommes vers un monde prétendument meilleur, se développe ainsi le récit biblique du peuple juif guidé par Moïse vers la Terre Promise. Est-ce à dire que les souffrances endurées par la population villageoise dans le roman sont justifiées, au même titre que celles endurées par le peuple juif ? C’est en tout cas ce que paraît suggérer le romancier : la souffrance serait le prix à payer pour accomplir une sorte de plan divin ou de dessein céleste.
L’épigraphe du Rêve (voir RVD, p. 5) fonctionne de la même façon. Yan Lianke cite les rêves de l’échanson, du panetier et de Pharaon contenus dans la Genèse (voir 40 :9-11, 40 :16-7 et 41 :1-7 et 17-24), mais il ne cite pas l’interprétation fournie par Joseph pour chacun de ces rêves. Dans le texte biblique, en effet, Joseph, qui se trouve en prison à cause de Putiphar, interprète les songes de l’échanson et du panetier en annonçant à l’un sa réhabilitation et à l’autre sa condamnation à mort ; puis il interprète le songe de Pharaon comme l’accomplissement de la volonté de Dieu : sept années d’abondance suivie de sept années de famine à laquelle il faut se préparer. Ainsi, un ordre supérieur s’applique, même au prix de la souffrance des hommes, et il semble bien qu’il faille l’accepter.
Cette idée de l’épreuve infligée aux hommes par un Dieu providentiel est encore illustrée par la figure de Job que Yan Lianke évoque dans le discours qu’il a tenu en 2014 lors de la remise du prix Kafka délivré à Prague : « Job a compris que la souffrance qu’il endure est une façon pour Dieu de le mettre à l’épreuve, et qu’elle était la preuve que l’obscurité et la clarté doivent coexister. » Il ajoute : « Nous devons accepter le bien accordé par Dieu et nous ne devrions pas accepter l’adversité ? »22 (Yan, 2014c).
Ces références canoniques ne laissent pas de poser un problème d’interprétation. En effet, comment concilier d’un côté cette justification de la souffrance et de l’autre la dénonciation, dans le registre satirique, des maux qu’un pouvoir politique inflige aux hommes ordinaires ? Ne décèle-t-on pas, dans cette justification, un écueil bien ancien dans l’histoire politico-philosophique de la Chine, celui de l’instrumentation à des fins politiques d’un discours philosophique qui repose sur le principe de la naturalité ? Car appliquer au domaine du pouvoir la logique même de la nature — tout vient en son temps, à propos pour assurer « régularité, équilibre et harmonie dans le cosmos » (Cheng, 1997, p. 286) —, n’est-ce pas le moyen de justifier au nom d’un principe supérieur (la nature ou plutôt le naturel) toutes sortes d’organisations politiques, y compris les plus oppressives ? Anne Cheng indique bien, dans son analyse de la pensée cosmologique de la résonance qui naît sous les Han, le danger potentiel qu’il y a à « représenter l’État comme naturel » et « le politique comme organique » (p. 287). On ne peut en effet envisager que Yan Lianke fasse ainsi le jeu d’un pouvoir dont il révèle les folies meurtrières.
Une solution consiste à interpréter les épigraphes sur le mode ironique : elles fonctionneraient alors comme les slogans ou les textes politiques que Yan Lianke pastiche, et seraient à mettre au compte de la parole des représentants du pouvoir dont on révèle ainsi les stratégies de manipulation. Cette interprétation est certes pertinente. Mais elle n’est pas exclusive d’une autre interprétation moins politique et plus philosophique, moins « moderne » et plus « conservatrice » aussi : ces références canoniques renvoient à un principe supérieur qui rend compte et par conséquent justifie la souffrance et le mal que les hommes subissent du fait des hommes. Il faut en effet se garder de vouloir à tout prix construire une cohérence dans le propos du romancier : il nous livre non pas un discours idéologiquement homogène, mais explore plutôt les contradictions de la réalité. Aussi doit-on admettre que deux discours, situés sur deux plans distinct, coexistent, sur le mode de l’obvie et sur celui de l’obtus, avons-nous dit : la dénonciation du pouvoir s’accompagne sinon d’une justification du désordre, du moins d’une tentative d’explication fournie par le modèle mythoréaliste que nous allons à présent essayer de préciser.
Nous avons cité cette phrase du discours de Prague : « l’obscurité et la clarté doivent coexister. » Yan Lianke ajoute : « L’obscurité n’est pas qu’une absence de lumière, c’est plutôt la vie même. L’obscurité, c’est le destin du peuple chinois »23 (Yan, 2014c). L’obscurité et la clarté forment les deux pôles, métaphoriques, du modèle mythoréaliste qui régit la conception de Yan à propos de la nature, et plus largement de l’histoire. On peut en effet distinguer dans ses romans une part d’ombre et une part de lumière, qui fonctionnent dans une logique cyclique.
La part d’ombre se traduit essentiellement par le motif du sacrifice. On pourrait penser, au premier abord, que le sacrifice mis en scène dans les romans à travers de nombreux personnages qui meurent plus ou moins volontairement, est conçu comme une étape nécessaire pour surmonter la mort et ramener la vie, dans une logique rituelle que la plupart des civilisations ont connue. C’est en effet le cas pour Les Jours, où le personnage principal de l’Aïeul (et de son chien) fonctionne, sans ambiguïté, comme la figure sacrificielle qui, par sa mort, permet au village de retrouver la vie. Alors que la sécheresse, point de départ du récit, a fait fuir tous les habitants du village, l’Aïeul est le seul à y retourner. Il fait penser au chamane (wū巫) qui, dans les pratiques rituelles de la Chine ancienne, s’expose au soleil pour appeler la pluie en cas de sécheresse, et qui, si la pluie ne vient pas, est effectivement sacrifié (voir Mathieu, 1987, p. 17). Du reste, le texte du roman fait allusion à ce rite sacrificiel à travers l’évocation d’une cérémonie où le chamane est remplacé par un chien :
Les années précédentes, lorsque la sécheresse arrivait, on dressait un autel à l’entrée du village. On y disposait trois assiettes d’offrandes et deux jarres. Dans chacune des jarres on versait généreusement de l’eau, puis sur chacune d’elle on dessinait un roi-dragon, dieu des pluies. Ensuite, on attachait un chien entre les deux récipients, on lui faisait lever la tête vers le ciel. On le nourrissait s’il avait faim, on lui donnait à boire s’il avait soif. Et, lorsqu’il était repu, on le faisait hurler face au soleil. Chaque fois qu’on a fait ça, au bout de trois à sept jours tout au plus, les aboiements faisaient effet et le soleil se retirait. Il se mettait alors à pleuvoir ou bien le vent se levait ou bien encore le ciel se couvrait. (JMA, p. 20-21)
À la fin du roman, l’Aïeul creuse une tombe en prévision de la mort du chien ou de sa propre mort, et explique au chien que le survivant n’aura qu’à enterrer celui qui mourra le premier, le corps décomposé servira d’engrais pour permettre à l’épi de maïs de poursuivre sa croissance (voir JMA, p. 140-141). En fait l’homme et le chien tous deux meurent et la pluie tant attendue se met à tomber : « La sécheresse perdura jusqu’à l’été suivant. Alors des nuages noirs apparurent enfin dans le ciel, s’amassèrent et se dispersèrent durant quinze jours, après quoi la pluie se décida à tomber » (JMA, p. 146). Pour bien faire comprendre la logique du sacrifice rituelle, Yan décrit le corps putréfié de l’Aïeul traversé par une végétation luxuriante :
Les racines de la culture (du plant de maïs) avaient progressé comme des lianes, roses et enchevêtrées ; elles parcouraient le cadavre en tous sens, sortant des trous des vers, se rejoignant sur le torse, les cuisses, les poignets et le ventre. Quelques-unes, aussi épaisses que des baguettes, traversaient le corps en décomposition pour aller se mêler à la chevelure blanche, puis redescendre vers les côtes. D’autres encore, plus fines et souples, rentraient dans les orbites pour ressortir à l’arrière de la calotte crânienne, plongeant ensuite profondément dans la terre. Chaque os, chaque morceau de chair putride était comme pris dans un filet de racines, lesquelles rejoignaient toutes la tige de la culture. (JMA, p. 151)
La mort est ainsi justifiée par la promesse d’un renouveau qui est clairement suggérée dans cette description, ainsi que dans les dernières lignes du roman où l’on fait comprendre que, malgré la famine qui s’abat à nouveau sur le village et qui provoque un nouveau départ des villageois, la vie sera néanmoins préservée grâce aux sept jeunes hommes qui restent pour s’en occuper : « Seuls demeurèrent sept garçons. Sept jeunes gens vigoureux qui dressèrent sept cabanes sur sept arêtes montagneuses. Dans la terre brune de sept champs, sous le soleil de plomb, ils semèrent sept grains de maïs, sept grains tendres et brillants. » (JMA, p. 153)
Dans les deux autres romans, le motif du sacrifice présente un caractère nettement plus ambigu. L’explication tient peut-être au fait que ces romans mettent en scène l’histoire de la Chine, tandis que Les Jours est une fable, s’inscrivant d’emblée et tout au long du récit dans un registre merveilleux. Tout se passe comme si, dans la fable, sur laquelle ne s’exerce pas la contrainte de la réalité historique, Yan Lianke livrait sa véritable position, alors que dans La Fuite et Le Rêve, le réel qu’il s’emploie à transposer, nécessairement plus complexe, introduisait un certain degré d’équivocité. Les deux romans comportent bien de nombreuses figures sacrificielles, mais le sacrifice ne débouche que temporairement sur un renouveau, et se révèle en définitive tragiquement inutile, instaurant un registre proprement absurde.
Dans La Fuite, c’est presque tous les personnages qui semblent se sacrifier. Dans le livre I, par exemple, on peut compter les dix-huit villageois morts pour la construction du canal (voir FT, p. 150), puis les sept morts que les hommes qui ont construit le canal ramènent en convoi funéraire lors de leur retour au village (voir FT, p. 159). Mais c’est sans doute Lan Sishi, la jeune femme aimée du chef Sima Lan, qui incarne le mieux la notion de sacrifice. Elle consent à faire « commerce de chair » à la ville de façon à financer l’opération médicale qui permettra à Sima Lan de ne pas mourir de la maladie de la gorge obstruée, et par conséquent de poursuivre la construction du canal qui, espère-t-on, pourrait garantir le salut des habitants du village. Or, une fois l’argent gagné et transmis, elle revient au village, mais ne veut plus connaître le sexe. Le canal est construit, puis les hommes reviennent, parmi lesquel Sima Lan, qui, se rendant chez Lan Sishi, découvre une scène d’horreur :
Sishi est morte.
Bien morte.
Couchée en travers du lit, elle porte son habituelle et simple chemise [...]. Ses jambes pendant hors du lit — deux longues courges jaune pâle. Allongée sur le dos, sa tête touche presque le mur, les yeux écarquillés fixent un point dans l’espace. [...] Chair et sang [...] scintillent au long des cuisses comme depuis le cœur d’une pivoine fanée. D’étranges effluves nauséabonds s’en exhalent et s’étirent vers l’extérieur. Le sang a imprégné le drap bleu océan et formé une galette pourpre sur le sol. (FT, p. 180)
Sima Lan la rejoint dans la mort : « Sima Lan s’endort pour longtemps avec Sishi » (FT, p. 186), si bien qu’on peut le compter lui aussi parmi les victimes sacrificielles.
On pourrait croire que les sacrifices ont, dans un premier temps, une certaine efficacité : l’eau acheminée au village grâce au canal semble mettre enfin un terme à la maladie de la gorge obstruée : « Période faste : personne n’a la gorge enflée ni aucun autre symptôme » (FT, p. 151). Après la mort du couple formé par Lan Sishi et Sima Lan, la nature semble retrouver une forme de paix : « Les journées d’automne se font tièdes et douces ; sur la vaste chaîne montagneuse, la lumière brille par petites étincelles. [...] Au village, tout est calme » (FT, p. 186). En effet, l’eau du canal suscite tous les espoirs : « le village entier vibre de cris puissants, comme sacs de céréales soudain pleins à craquer » (FT, p. 188). Pourtant, l’eau dont on espère les bienfaits se révèle être une eau polluée : « Herbes maculées, rats morts aux ventres gonflés, sacs de plastique emplis de fange, vêtements et chapeaux usagés, ventres rouges, peaux et poils blancs de bestiaux, tout cela se bouscule et se heurte à la surface de l’eau » (FT, p. 201-203). Dans chacun des cinq livres du roman se répète cette séquence où le sacrifice de quelques individus donne lieu tout d’abord à une lueur d’espoir collectif, qui, en définitive, se traduit par un nouveau lot de souffrances. Tous les chantiers qu’entreprennent les chefs du village connaissent en effet le même sort que le canal de Sima Lan (qui renvoie probablement, dans la réalité historique, à la construction du barrage des Trois-Gorges sur le Chang jiang) : ni la terre à retourner de Lan Baisui (les champs en terrasses), ni la monoculture du colza de Sima Xiaoxiao (le Grand bond en avant), ni enfin les communes populaires de Du Guanzi ne sont des succès.
Le même schéma ambigu est repérable dans Le Rêve. Le grand-père Ding Shuiyang correspond à la figure sacrificielle. Il est appelé le « Sauveur du Village des Ding » (RVD, p. 49), sans doute en référence au Christ rédempteur, mais l’allusion se fait au prix d’un renversement sémantique qui ôte toute pertinence à l’association entre le personnage et une figure salvatrice : c’est en effet Ding Shuiyang qui a mis en place la vente de sang dans le Village des Ding ; ce n’est pas lui qui verse son sang (comme le Christ), mais les habitants prétendument sauvés… Toutefois, le personnage connaît une évolution que l’on peut analyser comme une forme de « conversion ». Tout d’abord, dès l’apparition du sida, c’est-à-dire dix ans après le début de la collecte, il reconnaît ses torts, mais rejette la responsabilité sur son fils aîné, Ding Hui, qui a effectivement pris en main le système de commerce du sang (RVD, p. 64-65). C’est alors qu’il transforme l’école en un refuge destiné à accueillir et soigner les malades. Puis, sous la pression de Jia Genzhu et Ding Yuejin, qui s’emparent du pouvoir, il renonce à toute responsabilité dans le village (RVD, p. 175). Il finit par tuer son fils, pensant ainsi réparer sa faute originelle. En fait, dès le début du roman, il avait tenté de l’étrangler (RVD, p. 63) ; mais à la fin du roman, il semble entendre l’appel que lui adresse son petit-fils, l’enfant mort empoisonné qui est aussi le narrateur, lors de son enterrement :
— Viens vite à mon secours ! Sauve-moi ! Sauve-moi !
Alors, comme s’il [Ding Shuiyang] pensait soudain à quelque chose, son visage changea de couleur et ses mains se mirent à trembler. Il ramassa un gourdin en bois de châtaignier gros comme le bras et, à grandes enjambées, partit pour rattraper la foule qui suivait mon cercueil. Il ne lui fallut que quelques secondes pour la rejoindre. Mon père se retourna trop tard. Le gourdin s’abattit sur sa nuque. Il n’eut pas le temps de crier et s’effondra comme un sac de farine. (RVD, p. 379)
Il agit ainsi dans la fonction du héros éliminant un fléau qui pesait sur la communauté, sur le modèle des exploits héroïques des redresseurs de torts (wŭxiá武侠) qui « chassent le mal » (chúhài 除害) sévissant dans telle ou telle région24. Mais le village ne lui en sait pas gré : il est arrêté. C’est alors qu’il est clairement assimilé à une figure sacrificielle. Alors que le village souffre de la sécheresse depuis des mois, la rétention du grand-père a pour effet de ramener la pluie : « Trois jours après l’enterrement de mon père, on vint chercher mon grand-père. On l’arrêta pour homicide. Il avait tué mon père. On le garda trois mois. La pluie arriva » (RVD, p. 383-384). Le chiffre trois (« trois jours », « trois mois ») tire le récit vers le conte merveilleux, mais, associé aux circonstances d’une arrestation et d’un enterrement, il rappelle aussi la passion du Christ, crucifié et ressuscité après trois jours, annonciateur d’une nouvelle ère : « Sur le sol, l’herbe morte revivait. Dans les champs et dans l’ancien lit du Fleuve Jaune, on voyait réapparaître de timides traces de verdures. L’odeur qui flottait dans l’air était celle d’un début de printemps » (RVD, p. 387). Ding Shuiyang sauve la communauté du fléau de la sécheresse, comme le chamane auquel nous avions comparé l’Aïeul des Jours. Mais cette victoire semble ensuite dérisoire car à son retour au village, il constate qu’il n’y a plus personne : les villageois sont morts ou bien ont quitté le village.
Toutefois — il s’agit de la toute dernière page du roman —, le personnage assiste à un spectacle qui annonce une seconde fois un renouveau : « Mon grand-père aperçut, sortant de la boue qui recouvrait la plaine, une femme tenant à la main un rameau de saule qu’elle trempait dans la boue et secouait ensuite en l’air, faisant jaillir du sol une myriade de petits bonshommes d’argile. [...] Mon grand-père voyait surgir une nouvelle plaine. Il voyait surgir un nouveau monde » (RVD, p. 387). Un lecteur chinois un peu averti reconnaît dans ce passage une allusion à Nüwa (Nŭwā女娲ou Nŭwá女娃)25, la figure qui, dans la mythologie chinoise, a créé les hommes : « Nüwa pétrit de la glaise pour façonner les hommes. Elle y consacra toute son énergie et accomplit sa tâche sans répit. Puis, elle tira une corde du milieu de la boue et l’en souleva afin de former d’autres hommes »26 (Mathieu, 1989, n° 24, p. 63).
Ainsi, malgré les ambiguïtés et les incertitudes, un pôle de lumière, quelque fragile qu’il soit, vient équilibrer le pôle d’ombre qui semble dominer dans les récits de Yan Lianke. En fait, l’auteur associe ce pôle de lumière à une forme d’instinct de survie que les personnages opposent aux souffrances dont ils sont victimes :
Les paysans sont ainsi. Quand le fléau s’abat sur eux, ils vont souffrir quelques jours puis ils vont « accepter leur destin », ils vont endurer, et faire tout leur possible pour, de nouveau, faire face à la réalité et à la vie de tous les jours. Il s’agit chez eux d’un instinct de vie, et d’une aspiration spirituelle à vivre. Cette aptitude à vivre est quelque chose que les habitants des villes et les intellectuels ne peuvent pas posséder27. (cité dans Zhang Ying, 2006)
C’est encore cette force vitale qui étonne Yan Lianke lors de l’enquête qu’il a menée dans le Henan pour écrire Le Rêve : « [B]ien que l’ombre de la mort couvre le village année après année, jour après jour, leur amour et leur aspiration à vivre dépasse toute compréhension »28 (cité dans Zhang Ying, 2006). De même, dans la postface du Rêve, datée de 2005, il évoque son « amour de la vie » (RVD, p. 391).
Les deux thèmes principaux qui illustrent ce pôle de lumière sont en effet l’amour mais, auparavant, la sexualité. Celle-ci est présentée comme une manifestation vitale de résistance face à la mort, comme le montre la mise en scène des ébats érotiques de l’oncle de l’enfant-narrateur du Rêve, Ding Liang, et de sa maîtresse Lingling (épouse de Ding Xiaoming) :
— A quoi bon [faire l’amour] ? La vie n’a plus d’intérêt.
— L’intérêt d’une journée de vie de plus, c’est l’intérêt d’une journée de vie.
Il l’entraîna et la força à s’asseoir.
Ils s’allongèrent dans l’herbe sèche et firent l’amour.
[...] Ils firent l’amour frénétiquement, comme des fous, oubliant leur maladie et retrouvant toute leur énergie. (RVD, p. 146)
De même Zhucui, la femme disgracieuse et mal aimée de Sima Lan, connaît la jouissance sexuelle, et prend conscience de la force de la vie :
Maintenant, je sais que les femmes peuvent aussi connaître la jouissance ; je comprends enfin que la vie est bonne, je comprends pourquoi, sur le point de mourir, tu [elle s’adresse à son mari Sima Lan] as quand même voulu emmener tes trois filles s’agenouiller devant Sishi et la prier de t’aider à vivre encore un an ou deux. [...] Elle répète les mêmes paroles, confusément, presque en rêvant : C’est vraiment bon d’être en vie. (FT, p. 108)
À la fin de La Fuite du Temps (donc au début de l’histoire sur le plan chronologique), les enfants écoutent leur parents faire l’amour (voir FT, p. 560 sq.), puis les femmes sont enceintes (voir FT, p. 572) : c’est le triomphe de la vie. On compte « vingt-neuf à trente » (FT, p. 600) bébés nés dans le dernier livre, ce qui fait écho à la « trentaine » (FT, p. 492) d’enfants livrés à la mort lors de la famine dans le livre IV du roman.
L’amour, entendu comme l’attachement réciproque de deux individus, constitue également dans les romans un contrepoint à la mort, comme, vers la fin du Rêve, l’histoire d’amour entre Ding Liang (l’oncle du narrateur) et la femme de son cousin, Xia Lingling (voir RDV, chap. XII-XV). Ils envisagent une première fois le double suicide (dans la tradition japonaise du shinjū 心中), mais c’est la vie qui l’emporte encore puisque Ding Xiaoming refuse de mourir et le couple ne se suicide pas (voir RVD, p. 275). Ensuite, Lingling reprend des forces, mais c’est Liang qui dépérit : elle le « sauve » en se collant à lui après s’être aspergée de glace, mais c’est alors elle qui tombe à nouveau malade et meurt (voir RVD, p. 291-294). Le double suicide a bien lieu, exaltant l’amour dans la mort. Le même motif est associé au couple qui traverse La Fuite du temps, constitué de Sima Lan et Lan Sishi.
Le modèle mythoréaliste tel que nous avons tenté de le révéler, constitué d’un pôle d’ombre et d’un pôle de lumière, s’inscrit de façon assez évidente dans une logique cyclique. L’idée de cycle est présente dans la préface de La Fuite, où il évoque le « cycle de la prospérité et de la décadence » (voir le texte traduit en annexe), mais elle est aussi assez souvent suggérée au fil des différents récits. Ainsi le rêve du pharaon qu’interprète Joseph dans la Genèse, et qui est cité au seuil du Rêve du Village des Ding, décrit un cycle de quatorze années, où sept vaches grasses sont suivies de sept vaches maigres (voir RVD, p. 5). Cette idée est reprise dans la suite du roman par le chanteur de ballades Ma Xianglin : « Un jour de tristesse, un jour de joie [...] / Un jour beaucoup, un jour un peu » (RVD, p. 15), ce qui rappelle la célèbre formule du « Grand Commentaire » (Xì cí系辞) du Livre des mutations, ou Yì jīng (易经) : « Un yin, un yang, tel est le dao » (traduit par Cheng, p. 261), ou bien, celle de Mencius, qui s’applique davantage au champ politique : « Les périodes d’ordre ont toujours alterné avec les périodes de désordre » (Le Blanc & Mathieu, 2009, p. 381).
De même, dans Les Jours, alors que l’Aïeul est sorti vainqueur de la lutte contre les loups, il découvre, en revenant dans son champ, que son pied de maïs est mort. Mais il voit ensuite qu’une jeune pousse apparaît sur le végétal : « Il était sur le point de s’effondrer lorsque quelque chose gicla, éclaboussant son regard : c’était une goutte de verdure, au sommet de la culture, à la surface d’une feuille desséchée » (JMA, p. 105). Sans doute en référence à la parabole évangélique du grain de blé qui doit mourir pour donner du fruit29, Yan Lianke suggère que la mort est un passage obligé vers le renouveau. La référence à la parabole se poursuit quand les villageois reviennent au village et découvrent l’épi rempli de trente-sept graines, dont sept viables, les « sept grains tendres et brillants » (JMA, p. 152) qui sont les derniers mots du roman. Ainsi, la mort de l’Aïeul et du chien a permis le retour à la vie : tout le roman est régi par une logique cyclique où l’ombre cède en définitive à la lumière.
La Fuite du temps est également construit selon ce modèle circulaire, mais à l’échelle de chaque livre à l’intérieur du roman. En effet, presque chacun des livres du roman évoque la mort du chef du village : Sima Lan, puis (en remontant dans le temps, puisque le roman est construit à rebours de l’ordre chronologique) Lan Baisui (le père de Lan Sishi), puis Sima Xiaoxiao (le père de Sima Lan), enfin Du Guaizi et, avant lui, Du Sang. Il semble donc que chaque période de pouvoir exige son tribut à travers la mort du chef du village, figure sacrificielle qui permet le recommencement d’un nouveau cycle. Ainsi Yan se conforme à la conception chinoise traditionnelle de l’histoire, selon laquelle chaque dynastie correspond à un cycle avec une phase ascendante caractérisée par la « prospérité » (shèng 盛), suivie d’une phase descendante caractérisée par le « déclin » (shuāi 衰)30.
L’idée de cycle est également présente à l’échelle du roman tout entier. La structure inversée du roman (qui nous fait remonter le temps) fait qu’à la fin (de la lecture), on parvient au début (de l’histoire). Le lecteur accomplit en quelque sorte un cycle, ou plus précisément un mouvement de retour, de la mort vers la vie. À la fin du roman, Yan multiplie en effet les images renvoyant à la vitalité. En particulier, il décrit par trois fois une scène d’allaitement. C’est tout d’abord une femme que voient avec envie le petit Sima Lan ainsi que tous les jeunes enfants qui viennent d’être sevrés : « les seins blancs leur semblaient un soleil en plein hiver. Ils les fixent comme d’énormes jujubes, hument la délicieuse odeur de lait qui s’épand, dense, et dans leurs cœurs, haine et jalousie se lèvent, c’est avec avidité qu’ils boivent des yeux » (FT, p. 590). Puis, c’est une truie qui allaite ses petits : « Une truie, couchée en plein soleil, avec des yeux plissés qui lui donnent une expression sereine et souriante. Le long de son ventre, dix petits mamelons au moins scintillent, chacun tout aussi gonflé qu’un petit pain cuit à la vapeur, et le suc lacté en jaillit à flots » (FT, p. 593). Enfin, c’est Sima Lan lui-même au côté de Lan Sishi, car la mère de celle-ci lui offre son sein : « Ainsi font-ils connaissance, ainsi commence leur histoire d’amour. Lui au sein droit, elle au sein gauche » (FT, p. 595). Le couple qui, dans le premier livre du roman, meurt, est ici associé à la force vitale figurée par l’allaitement. La structure du roman rappelle ainsi le mouvement de retour (făn 反ou fù 复) propre à la tradition taoïste, mouvement qui consiste à remonter vers l’origine (le dào), source infinie de vitalité.
La logique cyclique qui régit le modèle mythoréaliste des romans de Yan Lianke renvoie tout autant à une conception circulaire de l’histoire entretenue par la tradition confucéenne, qu’au principe de la remontée vers l’origine inscrit dans la pensée taoïste. Mais elle peut encore renvoyer à la notion bouddhique de saṃsāra (ou cycle des renaissances) selon laquelle, à moins d’atteindre le nirvāṇa (ou extinction des désirs), chaque être est voué à renaître, c’est-à-dire à souffrir, puisque la naissance est la première des souffrances (ou duḥkha, voir Carré, 2001, p. 106) selon la doctrine bouddhique.
Toutefois, c’est plutôt dans le fonds mythologique grec qu’il faut chercher la clef d’interprétation du modèle mythoréaliste de Yan Lianke. En effet, la logique cyclique à l’œuvre dans les trois romans renvoie, de façon souterraine, à la figure mythique de Sisyphe, que Yan a surtout travaillée dans un autre de ses romans, intitulé Les Quatre Livres. Dans les trois romans qui nous ont retenu, le mythe de Sisyphe est repérable, mais seulement sur le mode de l’allusion. On peut tout d’abord qualifier la structure de La Fuite de sisyphéenne, dans la mesure où, de génération en génération, les villageois, à l’image de Sisyphe, subissent un lot de souffrances toujours recommencées. Mais, comme le remarque Tsai Chien-hsin dans son étude, le caractère sisyphéen de la structure tient aussi à l’ordre chronologique inversé : « dans la mesure où le roman est raconté en remontant le temps, le lecteur s’attend à un échec de type sisyphéen »31 (Tsai 2011, p. 92). En effet, de même que Sisyphe sait qu’une fois le rocher redescendu au bas de la montagne, il lui faudra à nouveau le pousser jusqu’au sommet, de même le lecteur, qui connaît la suite, sait, en entamant la lecture du deuxième cycle des souffrances qui se situe dans le passé, que celles-ci n’auront pas de fin : à la peine physique s’ajoute ainsi la peine mentale, c’est-à-dire la conscience que tout espoir d’échapper à la souffrance est vain.
La référence à Sisyphe est répétée discrètement à travers deux allusions. Les villageois qui retournent la terre (projet de Lan Baisui) et qui, pour cela, « [à] l’aide de chariots ou de palanches, [...] transvasent la terre du sommet vers le vallon » (FT, p. 338) rappellent Sisyphe qui pousse le rocher jusqu’au sommet puis qui le suit vers le pied de la montagne32. Par ailleurs, le personnage principal du roman, Sima Lan, semble bien, à plusieurs reprises, refuser de mourir, comme Sisyphe dont deux des forfaits renvoient à cette révolte majeure de la part d’un mortel. Le héros grec enchaîne tout d’abord Hadès, auquel Zeus l’avait confié pour le mener aux Enfers, si bien que les hommes cessent alors de mourir (voir Graves, 1958/1964, § 67, Tome I, p. 234). Finalement, Arès intervient pour libérer Hadès auquel il remet Sisyphe ; mais celui-ci, une fois aux Enfers, persuade Perséphone de le ramener sur terre parmi les vivants car, comme il l’avait préalablement recommandé à sa femme (et c’est là le second forfait), il ne lui a pas été accordé de sépulture. Au début du roman, alors que ses deux frères aménagent leur tombe, Sima Lan refuse, comme Sisyphe, que soit creusée une tombe pour lui-même (voir FT, p. 16). Par la suite, alors que tout est prêt pour ses funérailles, son « cercueil [...] soudé, les vêtements funéraires fin prêts, rangés dans les malles » (FT, p. 44), il reprend vie, se redresse et se rend auprès de Lan Sishi à qui il demande de se prostituer pour obtenir l’argent qui lui permettrait non seulement de retarder sa propre mort mais d’empêcher que ne meurent les autres villageois de la maladie de la gorge obstruée : « Si je peux tenir six mois encore, je pourrai achever la construction du canal de Lingyin et faire venir l’eau au village ; alors on pourra vivre jusqu’à cinquante, soixante, soixante-dix ou quatre-vingts ans » (FT, p. 49). En fait, en entreprenant la construction du canal, ce sont tous les villageois, conduits par leur chef, qui, comme Sisyphe, cèdent à l’hybris, et tentent de faire mourir la mort même.
Sisyphe est ainsi un représentant de l’homme qui n’accepte pas sa condition de mortel, ou du moins les souffrances qu’il subit durant son existence. Mais, dans Les Quatre Livres où le mythe fait l’objet d’une réécriture explicite, une fois soumis au supplice de la montagne et du rocher, Sisyphe connaît une évolution qui transforme le supplice en leçon philosophique. Yan Lianke s’appuie de façon transparente sur l’étude qu’Albert Camus a consacrée au mythe en 1942. Camus veut envisager non la montée pénible, pendant laquelle Sisyphe pousse le rocher, mais la descente de la montagne, car s’instaure alors une distance entre l’action subie et la conscience, distance qui, a priori, est à l’origine du sentiment de la condition « tragique » de l’existence, mais qui, tout aussi bien, peut procurer un sentiment de « joie », à condition de renoncer absolument à tout espoir de salut (Camus parle plutôt de « saut »), dans une logique transcendante. Tandis qu’il gravit la montagne, Sisyphe doit s’émanciper des « dieux » et du « ciel » qui constituent son horizon comme l’espoir illusoire d’un sort meilleur qui l’attend au sommet, pour, à l’inverse, entendre les « mille petites voix émerveillées de la terre » (Camus, 1942, p. 167), dans une logique « existentielle ». À cette condition, on peut « imaginer Sisyphe heureux » (p. 168).
Le Nouveau Mythe de Sisyphe (Xīn Xīxùfú shēnhuà 新西绪弗神话) est le texte qui clôt le roman Les Quatre Livres. Il s’agit d’un extrait du manuscrit qu’un des personnages, appelé l’Écrivain, a mis six années à écrire durant son séjour forcé dans une zone de « novéducation ». Comme Camus, Yan envisage un Sisyphe heureux. Dans un premier temps, il s’émancipe du sentiment de vivre une souffrance absurde : « [Sisyphe] n’a plus l’impression de subir un châtiment imposé par les dieux. [...] Parce qu’il est capable d’accepter l’absurdité, la peine et la punition, [il] est [...] un héros » (Yan, 2010/2012, p. 402). En effet, il a su « s’adapter » à sa condition qui, d’absurde qu’elle lui semblait, devient le sens même qu’il trouve à sa vie : « À la longue, il s’est adapté à ce que nous considérons comme un châtiment [...]. Ce cycle d’allers et retours, ce va-et-vient répétitif, Sisyphe les considère à présent comme son devoir, sa tâche. S’il venait à échapper à ce cercle temporel, à cet éternel, à cet inexorable recommencement, il aurait a contrario l’impression de se dilapider, son existence n’aurait plus de sens » (p. 403). Puis, dans un deuxième temps, le Sisyphe de Yan éprouve la « joie » dont parle Camus : alors qu’il redescend la pente — comme Camus en effet, Yan envisage la descente plutôt que la montée —, il rencontre un enfant avec lequel il communique et pour lequel il se prend d’affection : il connaît le « plaisir » (p. 405).
Outre l’essai de Camus, Yan a pu lire un texte du philosophe japonais Kuki Shūzō (九鬼 周造, 1888-1941), spécialiste de Henri Bergson, Edmund Husserl et Martin Heidegger, qu’il a rencontrés (ainsi que Jean-Paul Sartre)33 lors de son séjour en Europe à la fin des années 1920. En 1928, Kuki donne une conférence en français à Pontigny, publiée sous le titre « La notion du temps et la reprise du temps en Orient », publiée dans ses Propos sur le temps. Or, dans ce texte, Kuki opère déjà, comme Camus puis Yan, un renversement du sens habituellement associé au mythe de Sisyphe, en faisant du supplicié une figure paradoxale du bonheur. La proximité entre Kuki et Yan est en particulier repérable dans le fait d’expliquer ce renversement par le « devoir » (Yan) ou le « sentiment moral » (Kuki) :
Ce qui m’a paru toujours superficiel, c’est que les Grecs ont vu la damnation dans le mythe de Sisyphe. Il roule un roc jusqu’au sommet, et le roc retombe. Et il recommence perpétuellement. Y a-t-il du malheur, y-a-t-il de la punition dans ce fait ? Je ne crois pas. Tout dépend de l’attitude subjective de Sisyphe. Sa bonne volonté, la volonté sûre et ferme de se renouveler toujours, de toujours rouler le roc, trouve dans cette répétition même toute la morale, en conséquence tout son bonheur. Sisyphe devrait être heureux, étant capable de la répétition perpétuelle de l’insatisfaction. C’est un homme passionné par le sentiment moral. (Kuki, 1928/2013, p. 51)
Dans la suite de son texte, Yan propose une extension du mythe de Sisyphe tel que l’ont revisité Kuki et Camus. Zeus, s’apercevant que le supplicié prend goût à son supplice, modifie le châtiment : Sisyphe devra peiner en poussant le rocher sur l’autre versant de la montagne — ainsi, il ne verra plus l’enfant qui lui procurait du « plaisir » —, et surtout il devra pousser le rocher dans la direction allant du sommet vers le pied de la montagne34 — ainsi, il ne pourra pas concevoir d’espoir en fixant son regard vers le ciel :
[A]uparavant, tandis qu’il poussait, courbant les reins et arquant les jambes, il lui suffisait de lever la tête pour voir la lumière dans le ciel, le fait d’aller de bas en haut lui donnait l’impression de se rapprocher des cieux et des dieux, l’impression qu’un échange s’établissait entre eux. À présent qu’il va dans l’autre sens et ne voit plus ni la lumière ni les étoiles, il lui semble s’en éloigner, être proscrit du paradis et de l’esprit. (Yan, 2010/2012, p. 407)
Mais, le même phénomène que pour la première forme de châtiment se reproduit. Sisyphe finit par s’accoutumer à son sort, car il a su puiser la source d’une nouvelle forme de bonheur dans un horizon pourtant a priori fermé : « Un jour, comme autrefois lorsqu’il avait rencontré l’enfant sur le chemin, alors qu’il est en train de pousser avec énergie, son regard d’homme ployé sous l’effort se pose par-delà le rocher et il découvre, au pied de la montagne, la végétation, les maisons, les villages, les fumées des cuisines et, à l’entrée d’un temple, des enfants en train de jouer. » (Yan, 2010/2012, p. 409) Toutefois, Sisyphe ne commet pas la même erreur que la première fois, et dissimule aux yeux des dieux le nouveau bonheur dont il jouit : « Afin de se garder la possibilité de voir tous les jours le temple et les fumées des humains, afin d’éviter que les dieux brisent une fois de plus l’harmonie qu’il a trouvée, Sisyphe interdit à son regard de s’allumer lorsqu’il contemple le monde et sa réalité. » (p. 410)
Yan et Camus conçoivent un Sisyphe « heureux » (Camus, 1942, p. 168) ou « paisible » (Yan, 2010/2012, p. 411) malgré l’absurdité du monde dont il a conscience, précisément parce qu’il ne cherche pas à tout prix à donner un sens au monde dans lequel il vit : le Sisyphe de Camus « fait taire toutes les idoles » (Camus, 1942, p. 167), c’est-à-dire qu’il rejette les constructions métaphysiques qui reposent sur l’illusion d’une sortie hors de ce monde jugé absurde ; le Sisyphe de Yan ne cherche plus à comprendre et expliquer le sens de sa condition : « Il n’espère plus, il ne désire plus trouver le pourquoi de cette bizarrerie » (Yan, 2010/2012, p. 409). Tous deux trouvent le bonheur dans un univers quotidien, et s’accommodent de leur sort. Camus écrit : « Il n’y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit » (Camus, 1942, p. 167), phrase qu’aurait pu écrire Yan Lianke.
Toutefois, le Sisyphe camusien est un « révolté » dans le sens où il s’émancipe des dieux et de toute transcendance, de tout « maître » (p. 168), auxquels il oppose un « mépris » (p. 166) souverain. Le Sisyphe de Yan trouve le bonheur dans le quotidien, mais il n’a pas la prétention de se passer des dieux, ou en tout cas d’un principe supérieur qui dépasse l’humanité : le « Sisyphe oriental », comme le romancier chinois le nomme, s’inscrit davantage dans un processus naturel, où l’homme est dans une position d’équilibre entre le ciel, instance régulatrice, et la terre, qui constitue son horizon immédiat : « Le châtiment infligé par les dieux à Sisyphe était comme les quatre saisons, printemps, été, automne, hiver que le ciel impose à la terre » (Yan, 2010/2012, p. 402) En définitive, si le Sisyphe de Camus est « heureux » d’avoir « ni[é] les dieux » (Camus, 1942, p. 166) et de s’être émancipé de ses maîtres, celui de Yan Lianke « est paisible et satisfait, [...] naturel et content » (Yan, 2010/2012, p. 411, c’est nous qui soulignons).
3. Conclusion
À l’analyse, la question environnementale dans les trois romans de Yan Lianke que nous avons examinés n’est pas traitée de façon isolée35, mais se trouve replacée par deux fois dans un ensemble qui dépasse les contours stricts de l’écocritique. D’une part, elle s’inscrit dans un tableau politique général que Yan brosse à grands traits satiriques. Mais, de plus, la société des hommes est elle-même replacée dans un « univers », un « ciel-terre », qui tend, en définitive, non pas à corriger mais à compléter le premier discours. Il s’agit certes de dénoncer les aventures politiques qui aboutissent à des catastrophes humaines et en particulier environnementales, mais il faut aussi tenir compte d’un principe de régulation (le ciel) qui, dans une logique cyclique qu’illustre la figure mythique de Sisyphe, peut conduire à devoir subir un certain lot de souffrances. Il ne faut pas voir de contradiction entre le discours satirique (obvie) et le discours philosophique (obtus). Le sens obtus, précise Roland Barthes, « ne marque pas un ailleurs du sens (un autre contenu ajouté au sens obvie), mais le déjoue, subvertit non le contenu mais la pratique tout entière du sens » (Barthes, 1970/1892, p. 56). Il faut donc pratiquer deux lectures qui se situent sur deux plans distincts : une lecture politique, engagée, mais ancrée dans une vision traditionnelle chinoise, où prévaut le sens de l’équilibre entre l’homme et la nature.