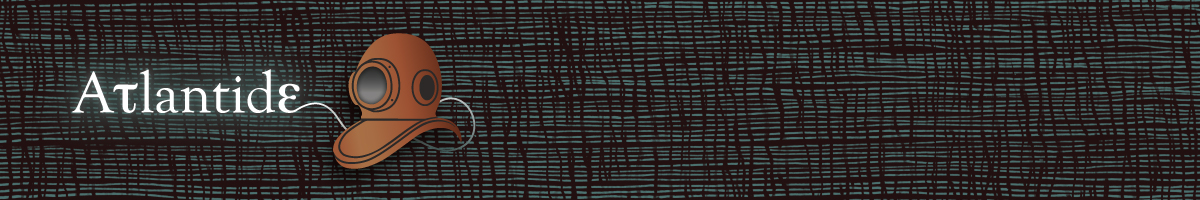Dès l’époque des peintres impressionnistes, la peinture a su représenter le caractère insaisissable de ce que l’on voit, résultant du jeu des lumières et des ombres qui ne sont jamais fixes1. Par conséquent, ces artistes ont privilégié une représentation subjective de la nature, une tendance qui sera ensuite renforcée par la photographie et le cinéma. En effet, la nature est profondément intriquée avec le langage cinématographique, et à l’écran elle est souvent utilisée pour autre chose qu’elle-même : elle permet de représenter et de comprendre des drames humains. En Orient, et en Chine en particulier, la nature devient même un élément avec lequel les personnages interagissent.
Cette caractéristique tire son origine des arts figuratifs traditionnels où la nature est souvent conviée pour explorer et révéler une autre nature, celle de l’homme ; nombreuses sont les peintures où il n’y a aucune distinction entre l’homme et ses actions dans la nature car celle-ci désigne tout ce qui prend part à la vie, si bien que l’homme devient « le centre d’un ensemble infini non anthropomorphique » (Mondzain, 1999). La peinture traditionnelle chinoise rend de façon magistrale cette unicité entre l’homme et la nature, et le cinéma, en s’en inspirant, la reproduit à son tour dans certains films. L’un des exemples le plus réussi est le film Impression de montagne et d’eau (Shān shuĭ qíng 山水情), réalisé en 1988 par Te Wei (Tè Wĕi 特伟, 1915-2010). Surprenant film sur la transmission du savoir d’un maître à son disciple, il frappe le spectateur par la force des images qui le transportent dans un environnement où la figure humaine est en harmonie parfaite avec la nature tout autour.
Figure 1. Te Wei, Impression de montagne et d’eau
Autre caractéristique des reproductions picturales des paysages naturels chinois : l’inscription calligraphique qui les accompagne de façon systématique. Comme le souligne Yolaine Escande (2005, p. 251), « elles transforment le lieu physique en paysage » : à celui qui parcourt les lieux virtuellement, avec son regard, ou bien physiquement, s’il se trouve, par exemple, près des inscriptions du mont Tai (Tài shān 泰山), non seulement elles indiquent ce qu’il verra, mais suggèrent aussi ce qu’il pourra sentir. Nous savons déjà que la peinture traditionnelle doit provoquer la participation active de celui qui l’observe. C’est un principe que certains réalisateurs chinois des années 1950 ont intégré dans une technique que Catherine Yi-Yu Cho Woo (1985, p. 23) définit comme « le montage chinois », à savoir une séquence de plans filmés qui alternent des scènes de vie humaine à d’autres présentant la nature, guidant le spectateur vers une perception de signes qui dépasse l’« ontologie »2 classique de l’image filmique. Si, pour le public chinois, l’interaction entre ce type d’images se révèle être efficace et si leur compréhension est immédiate, pour le public occidental une explication de la symbolique des images de la nature est souvent nécessaire. Prenons par exemple le film Les larmes du Yangzi (Yī Jiāng chūn shuĭ xiàngdōng liú 一江春水向东流), tourné en 1947 par Cai Chusheng (Cài Chŭshēng 蔡楚生, 1906-1968) et Zheng Junli (Zhèng Jūnlĭ 郑君里, 1911-1969) : la séquence initiale est de bout en bout un tableau de peinture traditionnelle. Le film s’ouvre en effet sur la scène d’un paysage du Yangzi (Yángzĭ Jiāng 扬子江) sur lequel sont reportés deux vers d’un poème de Li Yu3 (Lĭ Yù 李煜, 973-978), qui annoncent les péripéties que devra traverser le jeune couple protagoniste pendant le conflit sino-japonais :
Figure 2. Cai Chusheng et Zheng Junli, Les larmes du Yangzi, poème de Li Yu
问君能有几多愁?
恰似一江春水向东流!
Combien est grande ta peine ?
Comme les eaux d’un fleuve au printemps.4
Puis la caméra s’arrête d’abord sur la photo du mariage du couple, puis sur leurs deux oreillers brodés qui présentent eux-mêmes un motif de paysage naturel ; elle descend ensuite sur les deux paires de pantoufles, posées l’unes à côté de l’autre ; immédiatement après, la caméra se déplace d’abord sur une branche dénudée sur laquelle on perçoit des jeunes pousses, puis sur une nouvelle branche, dont on comprend toutefois qu’il s’agit de la même, qui est en revanche chargée de fruits. Ensuite, la caméra retourne à l’intérieur de la maison du couple, pour s’arrêter sur trois caractères brodés sur un bavoir : 小宝宝 (Xiăo Băobao, « Petit Trésor »).
La comparaison entre la transformation des jeunes pousses en fruits et le fruit de l’amour du couple qui naîtra bientôt est assez évidente. Ainsi, le « montage chinois », faisant alterner plans humains et plans naturels, suggère des idées que le spectateur n’a pas de mal à comprendre. Nous nous en apercevons dans le passage où la femme, devenue mère entre-temps, en pensant à son mari qui a dû quitter Shanghai (Shànghăi 上海) pour la ville de Chongqing (Chóngqìng 重庆), est surprise par un orage très violent qui annonce, justement, une catastrophe qui va survenir au sein du couple : nous apprenons en effet, dans la séquence suivante, que le mari de la jeune femme a succombé au charme d’une autre femme…
Pendant toute la période des années 1950 jusqu’au début des années 1960, l’esthétique cinématographique continue de s’enrichir en se tournant davantage vers les formes artistiques et littéraires de la tradition. Mais à côté de cinéastes tels que Zhang Junli et Cai Chusheng, qui continueront de s’exprimer à travers un cinéma original en interaction avec l’imagination active du public, il y en a d’autres qui succombent aux exigences d’un cinéma devenu désormais, sous Mao Zedong (Máo Zédōng 毛泽东), un art étatique. De ce fait, sa mission principale n’est plus celle de refléter la vie réelle mais aussi, et surtout, celle de célébrer le nouveau système politique et d’en assurer la pérennité. Par conséquent, le cinéma n’est plus le simple produit d’une culture ou son véhicule privilégié de diffusion : il est appelé à d’autres fonctions, notamment celle d’intervenir lui-même dans l’élaboration de cette culture.
Dans un tel contexte, la représentation de la nature n’est plus idéalisée mais « idéologisée » : il s’agit moins d’exprimer un équilibre idéal entre la nature et l’homme que de contribuer à en créer un nouveau entre l’homme et l’idéologie maoïste. Tourné en 1950 par Wang Bin (Wáng Bīn 王滨, 1912-1960) et Shui Hua (Shuĭ Huà 水华, 1916-1995), La Fille aux cheveux blancs (Báimáo nŭ 白毛女) est l’un des films les plus emblématiques de cette époque. La veille de son mariage, une fille est vendue, par son père ruiné, à un riche propriétaire foncier. Le vieil homme, honteux et désespéré, se suicide. Soumise aux caprices du seigneur, la jeune fille arrive à s’enfuir et se réfugie dans une grotte, où elle accouche d’un enfant mort-né. Ses cheveux deviennent tout blancs et les villageois la prennent pour une déesse. Finalement, après des années d’errance, elle est sauvée par un détachement de l’Armée rouge auquel appartient son ex-fiancé. La transition entre l’époque sombre qu’elle-même et tout le peuple chinois s’apprêtent enfin à quitter, et la nouvelle époque qui s’annonce radieuse, est soulignée par une végétation luxuriante et une riche moisson. Auprès de son fiancé retrouvé, même ses cheveux se transforment et redeviennent noirs.
Figure 3. Shui Hua et Wang Bing, La Fille aux cheveux blancs
 Après la mort de Mao et l’arrestation de la Bande des Quatre (1976), la Chine tourne la page, et son cinéma rejette en particulier la représentation pseudo-bucolique du monde rural perpétrée par le cinéma de propagande. La nouvelle génération de cinéastes, appartenant aux « jeunes instruits » (zhīqīng 知青) de retour des campagnes où ils avaient été envoyés pour une longue et douloureuse « rééducation »5, s’exprime alors à travers un cinéma qui renoue le dialogue avec une nature dénuée de tout revêtement idéologique, où l’homme peut enfin trouver du réconfort. Nombreux sont les témoignages de ces cinéastes, devenus fameux sous le nom de la « Cinquième génération »6, sur la façon dont la nature a soigné leurs souffrances et les a aidés à reconstruire leur propre identité. Chen Kaige (Chén Kăigē 陈凯歌, 1952-), par exemple, dit avoir retrouvé le sens du mot dignité en voyant les feuilles de mimosa se rétracter à son passage (voir Kramer, 1996, p. 316). Pour Xie Fei (Xiè Fēi 谢飞, 1942-), après des années de fureur idéologique, seule la réappropriation de la nature pouvait assurer au peuple chinois le recouvrement de son identité non seulement en tant qu’individus mais surtout en tant que peuple : « La société à l’époque était encore constituée à 80 % de paysans […]. Pour nous, la vraie société chinoise se trouvait là, dans les campagnes, et notre proximité avec elle nous a permis d’en parler. » (cité dans Paccellieri, 2017)
Après la mort de Mao et l’arrestation de la Bande des Quatre (1976), la Chine tourne la page, et son cinéma rejette en particulier la représentation pseudo-bucolique du monde rural perpétrée par le cinéma de propagande. La nouvelle génération de cinéastes, appartenant aux « jeunes instruits » (zhīqīng 知青) de retour des campagnes où ils avaient été envoyés pour une longue et douloureuse « rééducation »5, s’exprime alors à travers un cinéma qui renoue le dialogue avec une nature dénuée de tout revêtement idéologique, où l’homme peut enfin trouver du réconfort. Nombreux sont les témoignages de ces cinéastes, devenus fameux sous le nom de la « Cinquième génération »6, sur la façon dont la nature a soigné leurs souffrances et les a aidés à reconstruire leur propre identité. Chen Kaige (Chén Kăigē 陈凯歌, 1952-), par exemple, dit avoir retrouvé le sens du mot dignité en voyant les feuilles de mimosa se rétracter à son passage (voir Kramer, 1996, p. 316). Pour Xie Fei (Xiè Fēi 谢飞, 1942-), après des années de fureur idéologique, seule la réappropriation de la nature pouvait assurer au peuple chinois le recouvrement de son identité non seulement en tant qu’individus mais surtout en tant que peuple : « La société à l’époque était encore constituée à 80 % de paysans […]. Pour nous, la vraie société chinoise se trouvait là, dans les campagnes, et notre proximité avec elle nous a permis d’en parler. » (cité dans Paccellieri, 2017)
Après avoir connu des lieux marqués par l’idéologie, l’individu mis en scène dans le cinéma de la Cinquième génération réapprend à s’approprier les grands espaces, les vastes plaines chinoises : si, dans les films de l’époque maoïste, chaque espace est occupé par un soldat ou un héros, dans Terre jaune (Huáng Tŭdì 黄土地, 1984), réalisé par Chen Kaige, comme dans d’autres films de la même époque, la présence humaine est quasiment insignifiante ou du moins traitée de façon subalterne par rapport à la nature. Le plus souvent, l’homme se régénère au contact de la nature. Toutefois, dans le cinéma de Zhang Yimou (Zhāng Yìmóu 张艺谋, 1951-), autre cinéaste phare de la Cinquième génération, l’individu a besoin d’une autre force impérieuse, celle de l’amour, pour s’identifier davantage à l’univers. Dans Le Sorgho rouge (Hóng gāoliáng 红高粱, 1987), adapté du roman de Mo Yan (Mò Yán 莫言, 1955-), la nature constitue le décor idéal pour un amour passionnel qui naît parmi les sorghos sauvages. Dans la scène où les jeunes amants font l’amour la première fois, la jeune fille est filmée de très haut :
She is not filmed from her lover’s perspective, but from far above, as if the camera looks down upon her from the perspective of all-embracing heaven. Lying on the intersection between heaven and earth, she spreads her arms and legs as if to absorb their vital energy flows into her body. (Chong, 2000, p. 204)
Elle n’est pas filmée du point de vue de son amant, mais loin par-dessus, comme si le regard posé sur elle était celui du ciel qui enveloppe toute la terre. Couchée à l’intersection du ciel et de la terre, elle étend les bras et les jambes comme pour absorber en son corps l’énergie vitale de l’un et de l’autre. (Notre traduction)
Le vent de libéralisation qui souffle en Chine à cette époque pousse également certains cinéastes à représenter la nature de façon moins mystique mais d’une manière toujours hautement symbolique. C’est le cas d’un documentaire étonnant diffusé en plusieurs parties sur la chaîne officielle CCTV pendant l’hiver 1988. Il s’agit de L’Élégie d’un fleuve (Héshāng 河殇), de Xia Jun (Xià Jùn 夏骏, 1962-), Su Xiaokang (Sū Xiăokāng 苏晓康, 1949-) et Wang Luxiang (Wáng Lŭxiāng 王鲁湘, 1956-). Le film dresse une analogie entre le fleuve Jaune, berceau de la civilisation chinoise, au cours desséché, et la situation de la Chine, également desséchée du fait de l’isolation et du conservatisme de ses dirigeants. Les séquences initiales montrent des images du fleuve Jaune en opposition avec des images de la ville de New York.
D’autres images se succèdent toujours dans le respect d’une dichotomie chromatique jaune et bleu qui symbolise respectivement la couleur de la Chine classique (en se référant au fleuve Jaune), et celle de la mer, synonyme d’ouverture et de progrès. De même qu’un fleuve ne peut renoncer à se jeter naturellement dans la mer, de même la Chine ne pourra pas toujours refuser de s’ouvrir à l’Occident et à ses idées : c’est ce message transmis par les réalisateurs qui poussera les autorités à interdire la diffusion du documentaire en Chine ainsi que son exportation.
Figure 4. Su Xiaokang, Xia Jun, Wang Luxiang, L’Élégie d’un fleuve
À la suite de l’échec des demandes de réformes institutionnelles émises lors du mouvement de Tian’anmen, la Chine tourne une nouvelle page. Son cinéma aussi. De nombreux intellectuels, désillusionnés après le massacre du 4 juin 1989, recherchent les causes fondamentales de l’échec du mouvement. On formule une critique de l’élite intellectuelle et l’on déplore l’absence d’une démocratisation culturelle pouvant atteindre la base de la société chinoise. C’est dans ce contexte que certains réalisateurs appellent à prêter davantage d’attention aux groupes défavorisés de la société chinoise. La génération suivante de cinéastes chinois — la Sixième génération — opte, elle aussi, pour une approche plus « démocratique » du cinéma qui devient alors un espace de réflexion sur la privation des droits qu’avaient en quelque sorte subie les participants du mouvement de Tian’anmen. Aussi les laissés-pour-compte de la société deviennent-ils les protagonistes du nouveau cinéma qui se concentre de ce fait sur des aspects de la réalité chinoise jusque-là peu explorés. La représentation symbolique de la nature est écartée, et la campagne devient le lieu de vie et de travail de paysans qui semblent ne pas profiter des effets des réformes économiques.
Dans les premiers films des années 1990, les villages de la campagne sont encore représentés comme de petits havres de paix où, par rapport au chaos qui règne dans les villes, on peut encore vivre tranquilles et se ressourcer. Tel est le cas de Qiu Ju, une femme chinoise (Qiū Jú dă guānsi 秋菊打官司, 1992), qui oppose les vastes paysages de la campagne au cadre urbain labyrinthique où la protagoniste, errant de ville en ville et d’administration en administration, tente d’obtenir justice pour son mari.
Lors de la décennie suivante, c’est toute une autre campagne que les spectateurs découvrent à l’écran. Plus de dix ans de réformes ont complètement changé le visage du pays en provoquant, entre autres conséquences, l’exode de millions de paysans vers la ville, créant ainsi une urbanisation sans précédent. Cela a entraîné une modification radicale de la vision de la nature et de la vie rurale ainsi que de leur représentation à l’écran, si bien que les films ne célèbrent plus une nature macrocosmique qui épouse de façon harmonieuse la vie des hommes, mais révèle plutôt une nature qui écrase les vies humaines chamboulées par la brutalité des changements voulus et apportés pourtant par les hommes.
Le film Still Life (Sānxiá hăorén 三峡好人, littéralement « Les Braves Gens de la zone des Trois-Gorges », 2006) de Jia Zhangke (Jiă Zhāngkē 贾樟柯, 1970-) confirme l’éloignement d’une nature vivante en harmonie avec l’univers, désormais remplacée, comme l’indique le titre tel qu’il est traduit en anglais, par une « nature morte ». En fait, bien que plusieurs plans du film présentent une grande variété de paysages, ils ne sont plus l’expression d’une nature dans laquelle se trouve englobée harmonieusement la vie des hommes, mais bien plutôt la représentation d’une nature qui pèse sur la vie quotidienne. Le réalisateur arrive dans la ville de Fengjie quelques mois avant la fin des travaux de l’immense barrage construit dans la région des Trois-Gorges7. Il a l’intention d’y tourner un documentaire (Dong [Est], Dōng 东, 2006) avant que la ville ne soit engloutie par les eaux du Yangzi. Sur place, il se trouve face à un véritable paysage qu’il a du mal à comprendre : d’une part, la zone la plus en aval est complètement submergée par les eaux, d’autre part, la zone en amont est réduite à un immense tas de décombres, avec des centaines d’ouvriers armés de pioches démolissant les derniers bâtiments, tandis que des milliers de personnes abandonnent leurs maisons pour se déplacer vers la partie la plus haute de la ville ou pour émigrer vers d’autres régions. En regardant la ville de l’extérieur, du haut des quelques immeubles encore debout ou des collines qui la surplombent, le quartier ressemble à une immense nature morte. Il a alors l’idée de réaliser également une fiction (Still Life), afin de créer une sorte de diptyque, le premier volet voué au travail des ouvriers dans un chatoiement impressionnant de couleurs, l'autre au désarroi existentiel et social provoqué par cette situation. L’équilibre superbe entre vide et plein, principe de base de l’esthétique traditionnelle chinoise, cède ici la place à une nouvelle alternance entre espaces vides et pleins, à savoir respectivement entre le dépeuplement des villages et leur remplissage successif dû à l’eau du réservoir.
À l’heure actuelle, la nécessité de rétablir une relation harmonieuse entre l’homme et la nature est évidemment une priorité politique plutôt que cinématographique. Les scientifiques sont de plus en plus alarmés par les conséquences de la pollution de l’air, des rivières et des eaux souterraines sur la santé humaine. Les traces de métaux lourds (arsenic, fluor, sulfate de sodium) et d’autres matières hautement toxiques font qu’au moins 35 % des eaux chinoises ne peuvent pas être bues car cela entraînerait la mort par empoisonnement, avec un risque très élevé de développement de maladies tumorales. Par conséquent, le gouvernement chinois se montre maintenant plus sensible aux questions environnementales. De même, la nouvelle génération de cinéastes met l’accent sur l’urgence de devoir corriger les conséquences néfastes de la politique économique. Du documentaire à la fiction, en passant par le cinéma expérimental, tous ces genres sont confrontés à ce qui est en passe de devenir une véritable mode : le filon « ciné-écologique ».
Appartient à cette catégorie le film-documentaire The Warriors of Qiugang (Qiúgāng wèi shì, 仇岗卫士) tourné en 2010 par Ruby Yang (Yáng Zĭyè 杨紫烨, c. 1957-). La cinéaste interviewe les habitants de Qiugang, un village de la province de l’Anhui (Ānhuī 安徽), situé près d’une usine de pesticides qui ont fini par empoisonner les eaux et les terres en provoquant la mort de milliers de poissons ainsi que le déclenchement de maladies mortelles chez les humains. À travers la lutte de Zhang Gongli (Zhāng Gōnglì 张功利), un paysan dont les champs ne sont plus exploitables, Ruby Yang découvre un autre type de nature : celle qui règle les rapports et les connivences entre pouvoir politique et pouvoir économique.
Jin Huaqing (Jīn Huáqīng 金华青, 1984-) est un autre cinéaste militant converti à la cause écologique. Dans Desire of Changhu (Chánghù de kĕwàng 常沪的渴望, 2011) il filme l’oasis de Minqin (Mínqín 民勤), dans la province du Gansu (Gānsù 甘肃), une oasis qui risque de disparaître à cause de l’avancée du désert8. En effet, les déserts de Badain Jaran, de Tengger et de Kumtagh risquent de finir par se rejoindre à cet endroit précis. De la co-existence pacifique et harmonieuse entre l’homme et la nature, nous sommes désormais passés au combat, celui lancé par l’homme contre le désert qui avance inexorablement. Autre grand thème de ce filon, la construction du barrage des Trois-Gorges, qui a suscité une vaste polémique, tant en Chine que dans le monde. Up the Yangtze (Yánjiāng Érshàng 沿江而上), de Zhang Qiaoyong (Zhāng Qiáoyŏng 张侨勇, ou Yung Chang, 1977-) revient en 2008 sur la ville de Fengjie dont la disparition proche avait déjà été évoquée par Jia Zhangke dans Still Life. Présenté au Festival International du film de Human Rights Watch à Londres la même année, ce film conteste vivement la construction du gigantesque barrage des Trois-Gorges. La condamnation du réalisateur est sans appel : « Notre pays ne fait que brasser... La préservation de la culture, il ne sait même pas ce que c’est... » (cité dans Geall, 2008).
Qiu Anxiong (Qiū Ànxióng 邱黯雄, 1972-) quant à lui, replace la nature dans une perspective culturelle très ancienne : il a en effet réalisé en 2006 The New Book of Mountains and Seas (Xīn Shānhăi jīng 新山海经, 2006), une fascinante allégorie du monde moderne inspirée par l’un des grands classiques de la littérature mythologique chinoise, le Livre des monts et des mers9 (Shānhăi jīng 山海经, voir la traduction de Mathieu, 1983). Tout comme cette œuvre se voulait une description du monde de l’époque, avec une quantité impressionnante de notions géographiques et de légendes diverses, le film de Qiu Anxiong revisite le monde moderne, avec ses monstres et ses mythes. Ainsi, les représentations allégoriques du monde moderne choisies pour illustrer les horreurs de l’urbanisation et de l’industrialisation sauvage sont extrêmement efficaces : des tortues se nourrissent de pétrole ou des oiseaux noirs menaçants émergent des dunes du désert et se transforment en chasseurs-bombardiers contribuant à créer une image apocalyptique de notre univers.
Figure 5. Qiu Anxiong, The New Book of Mountains and Seas
 Il s’agit aussi d’un film impressionnant du point de vue esthétique, surtout pour les premières séquences qui montrent le monde avant l’impact avec l’urbanisation. Ce sont des images réalisées grâce à une technique unique : elles sont peintes une par une avec des couleurs acryliques, puis filmées avec la technique numérique et enfin animées par ordinateur, technique qui combine habilement la sophistication moderne et le style de la peinture traditionnelle.
Il s’agit aussi d’un film impressionnant du point de vue esthétique, surtout pour les premières séquences qui montrent le monde avant l’impact avec l’urbanisation. Ce sont des images réalisées grâce à une technique unique : elles sont peintes une par une avec des couleurs acryliques, puis filmées avec la technique numérique et enfin animées par ordinateur, technique qui combine habilement la sophistication moderne et le style de la peinture traditionnelle.
La liste est loin d’être exhaustive tellement le nombre de films consacrés à cette thématique est important. Une mention particulière doit être faite pour le documentaire Under the Dome (Qióngdĭng zhi xià 穹顶之下, 2015) de la journaliste Chai Jing (Chái Jìng 柴静, 1976-) sur la pollution atmosphérique. Face à un public nombreux, la journaliste commente les résultats de son enquête qui aurait pour origine ses propres inquiétudes de mère concernant la santé de son bébé. À l’écran défilent avec une précision étonnante de courts reportages ainsi que des interviews de scientifiques et de responsables administratifs. Si elle n’est pas la première à aborder ce thème, Chai Jing met en lumière comme jamais auparavant les responsabilités de chacun, à commencer par les entreprises publiques des secteurs du charbon et du pétrole. Elle montre notamment comment l’État se plie devant celles-ci quand il s’agit de fixer des normes de raffinage et ose souligner également l’impuissance du Ministère de l’Environnement. Mais Chai Jing pose également des questions au spectateur qui prend sa voiture pour quelques centaines de mètres et se gare sur la piste cyclable, en l’incitant à assumer son rôle de citoyen et à agir. Diffusé le samedi 28 février 2015 sur Internet, le documentaire a connu un succès fulgurant, puisque il a été vu plus de 155 millions de fois en deux jours seulement ! Un succès qui avait même valu à la réalisatrice les félicitations du Ministère de l’Environnement, avant que les autorités chinoises fassent finalement un pas en arrière en décidant non seulement de le retirer des principaux sites chinois mais aussi en en bloquant l’accès depuis des sites étrangers.
La nature, tantôt idéalisée, « idéologisée » ou bien « écologisée », telle qu’elle est représentée dans le cinéma chinois, n’a jamais servi de simple toile de fond aux vicissitudes humaines. Au-delà de la dimension descriptive et esthétique qu’elles comportent dans les films, les terres traversées par le fleuve Jaune ou les plaines baignées par le Yangzi ont indéniablement une portée culturelle, sociale ou même politique, en fonction de l’époque considérée. Les cinéastes d’aujourd’hui, de plus en plus aux prises avec les problèmes d’ordre non seulement politique mais aussi économique pour la réalisation de leurs films, sauront-ils se consoler avec les mots de Virgile : « Si canimus silvas, silvae sint consule dignae... » (« Si nous chantons les forêts, que les forêts soient dignes d’un consul… »).